|
- Petit rappel historique sur la bourgeoisie -
En Suisse, la bourgeoisie est un droit personnel, survivant du droit médiéval. la bourgeoisie ou commune bourgeoise
est aussi une collectivité locale, qui existe encore dans certains cantons, à laquelle participent les habitants
originaires de la commune ou anciens bourgeois, par opposition aux nouveaux habitants. La bourgeoisie, qui est une
institution remontant à la loi sur les communes de 1866, a perdu de l'importance, mais gère encore des hôpitaux,
et dans quelques cantons confère encore un « droit de bourgeoisie » préalable à l'obtention de la naturalisation.
Le droit de bourgeoisie est une survivance de l'ancien droit de cité médiéval, lequel a été progressivement
étendu aux communautés rurales. Dans certaines communes on trouve donc encore "la commune bourgeoisiale" composée
des "bourgeois" et "la commune politique" composée des "habitants". L'appartenance à la commune bourgeoise est
parfois encore liée à quelques droits (paturages, vignes, etc..).
Les bourgeois, parfois appelés communiers, sont enregistrés dans les registres bourgeoisiaux (ou registres des
familles) de leur(s) commune(s) d'origine quelque soient leurs lieux de naissance, mariage et décès. Le généalogiste
trouvera donc en un même lieu les informations concernant une même famille. Ce système a été généralisé en Suisse
dès 1928, mais certaines communes urbaines possèdent des registres bourgeoisiaux pouvant remonter à la fin du Moyen
Age. Dans certaines communautés urbaines on trouvait jusqu'en 1848 différentes catégories de bourgeois: nobles,
patriciens, externes, forains, etc... De 1848 et jusqu'en 1996, il y avait égalité entre tous les bourgeois d'une
même commune d'origine.
Au sens actuel, la bourgeoisie est une couche sociale, ensemble différencié de personnes appartenant à la classe
moyenne supérieure et disposant d'une fortune et d'une formation intellectuelle. Il est plus aisé de la définir
par des critères culturels qu'économiques. Elle connut son "âge d'or", du moins en Europe occidentale, entre les
révolutions de 1848 et la Première Guerre mondiale. Elle a exercé une influence particulièrement durable en Suisse,
où la noblesse avait déjà perdu le pouvoir au début de l'époque moderne. L'origine de la bourgeoisie remonte aux
XIIe-XIIIe s., époque des fondations de villes, dont les habitants privilégiés reçurent le nom de bourgeois,
d'où le sens ancien du terme. Au cours des aléas de son histoire, cette bourgeoisie urbaine, dont une partie
tendit à se transformer en aristocratie aux XVIe-XVIIIe s., s'est élargie grâce à l'apport de nombreux éléments
ruraux.
- La bourgeoisie urbaine médiévale.
Les villes et Villes neuves du Moyen Age acquirent, dans le territoire de la Suisse actuelle comme en Italie,
en France, aux Pays-Bas et dans l'Empire, un statut privilégié par rapport aux campagnes. Les personnes qui s'y
établissaient étaient libérées au bout d'une année et un jour de leurs liens personnels de servitude, d'où le
dicton allemand Stadtluft macht frei, "l'air de la ville rend libre". Le Droit de cité s'obtenait sous certaines
conditions (fortune minimale, possession d'une maison ou long séjour). On pouvait le gagner en participant à une
campagne militaire, l'acheter (voie ouverte aussi aux femmes), le recevoir éventuellement d'une ville qui cherchait
à s'attacher des personnalités capables. Par héritage, il passait à la veuve et aux enfants mineurs. On le perdait
soit par renonciation formelle, soit par exclusion pénale. Après une guerre ou une épidémie, les villes comblaient
habituellement les pertes en conférant généreusement leur droit de bourgeoisie. Cela se pratiqua dans plusieurs
villes suisses au bas Moyen Age et les plus riches des nouveaux venus purent même accéder assez facilement aux
Conseils. L'essor démographique de l'époque moderne mit fin à ces pratiques d'ouverture.
Les hommes et les femmes admis à la bourgeoisie avaient divers droits: pas d'attachement à la glèbe, liberté (relative)
de tester, protection et, pour les hommes, droit de participer à l'administration urbaine. La ville tentait de
soustraire ses bourgeois à toute juridiction extérieure, pour ne pas devoir les assister devant des tribunaux
étrangers. Chaque année, les bourgeois prêtaient un serment de fidélité qui engageait aussi le Conseil et le
seigneur de la ville. Ils juraient obéissance à ces derniers, promettaient d'accomplir leurs devoirs, d'observer
les lois et usages locaux, de maintenir la paix publique. Les bourgeois étaient tenus de monter la garde et de
porter les armes pour la ville (quant aux femmes et veuves qui avaient acheté ou hérité le droit de bourgeoisie,
elles devaient fournir un remplaçant). Hommes et femmes étaient soumis à l'impôt direct sur la fortune, perçu
seulement en cas de besoins accrus, plus fréquents, dans la Confédération, au bas Moyen Age, à cause des guerres
et des acquisitions territoriales, qu'à l'époque moderne. Les bourgeois étaient privilégiés par rapport aux Habitants,
mais plutôt au point de vue politique qu'économique. On appelait bourgeois externes ou forains ceux qui résidaient
hors de la ville; à l'origine, il s'agissait de serfs qui tentaient d'échapper à leur seigneur en se faisant recevoir
dans une bourgeoisie. Dans le cadre de leur politique territoriale, certaines villes accordèrent la Combourgeoisie à
des seigneurs qui parfois prirent un domicile citadin. Aux XIVe-XVe s. déjà, dans la Confédération, la noblesse
avait subi un tel déclin économique et politique qu'elle avait perdu sa prépondérance.
Une première série de Révoltes urbaines opposa aux XIIe-XIIIe s. des factions de l'élite traditionnelle à des
exclus de la vie politique, par exemple des marchands, devenus riches et considérés. Le but de ces nouveaux
groupes était de se libérer du seigneur de la ville et/ou de renverser les dirigeants. Les protagonistes de
la seconde phase de soulèvements (XIVe-XVe s.) furent les artisans, majoritaires au sein de la bourgeoisie.
Dans de nombreuses villes de Suisse et du sud-ouest de l'Allemagne, les artisans organisés en Corporations
obtinrent des droits politiques, tels que la participation au Conseil. Mais aux XVe-XVIe s., même dans les
Villes corporatives , des tendances aristocratiques apparurent, limitant les droits et pouvoirs des simples
bourgeois.
L'essor démographique du XVIe s. entraîna une diminution des ressources qui conduisit à rendre l'accès à la
bourgeoisie de plus en plus difficile, voire, dans la seconde moitié du XVIe s., presque impossible en bien des
villes. La conséquence fut une augmentation du nombre des "habitants" non bourgeois, parfois divisés en deux
catégories (habitants et natifs à Genève, dont les possibilités d'ascension sociale différaient, Habitanten
et Hintersassen à Berne selon l'ordonnance de 1643, les seconds étant plus défavorisés, cittadini antichi
et avventizi derniers arrivés à Lugano). La part des bourgeois dans la population totale était très variable:
à Zurich 85% en 1671, 62% vers 1780; à Genève 33% vers 1720, 27% vers 1780. Zurich limitait les autorisations
d'établissement, parce qu'il était plus avantageux pour les entrepreneurs du textile d'employer des travailleurs
à la campagne; Genève en revanche, maîtresse d'un tout petit territoire, devait accueillir dans ses murs les
ouvriers de ses industries (horlogerie, dorure).
La bourgeoisie elle-même était très stratifiée. A Berne, Lucerne, Fribourg et Soleure, quelques familles
monopolisaient de plus en plus le gouvernement. Les Conseils se cooptaient, rendant les sièges héréditaires
de fait. Le Patriciat ainsi formé vivait des charges publiques, du service étranger et du revenu de ses terres.
Distinct par droit de naissance du reste des bourgeois, il imitait le genre de vie de la noblesse.
Les assemblées communales, quand on les convoquait encore, n'étaient plus que des formalités. A Lucerne, il
était interdit de prendre la parole ou même de présenter une requête sans l'autorisation du Conseil. Cette
mise à l'écart provoqua dès le milieu du XVIIe s. des révoltes, qui cependant ne purent inverser la tendance.
Les campagnes faisaient généralement les frais des concessions arrachées au patriciat (par exemple mesures
favorisant l'artisant urbain). Genève, ville de loin la plus agitée au XVIIIe s., a mérité le surnom de "laboratoire
de la révolution". L'Oligarchisation a aussi touché Zurich, Bâle et Schaffhouse, même si les corporations y élisaient
une partie des conseillers. Aux XVIe et XVIIe s., les artisans se virent supplantés par des familles de riches
marchands, d'entrepreneurs textiles, de banquiers et de rentiers, qui infiltraient les corporations et cumulaient
les sièges de conseillers, et qui affichaient des tendances aristocratiques (genre de vie, maison de campagne),
moins poussées cependant que dans les cantons à patriciat. Il subsistait une certaine mobilité sociale, fondée
sur les succès ou les échecs commerciaux, critère d'accès à la classe dirigeante. Cette mobilité se constate
aussi à Bâle et Genève, où cependant un petit nombre de familles accaparait plus le pouvoir qu'à Zurich.
Dans les villes tournées vers le commerce, la protoindustrie et les affaires de finance, la couche supérieure
liée à ces activités s'accrut fortement aux XVIIe et XVIIIe s.: à Zurich, les marchands représentaient 2,6%
des bourgeois en 1599 et 12,4% en 1790. Ils formaient le noyau d'une bourgeoisie au sens moderne du terme, dont
les valeurs caractéristiques sont le rendement, la concurrence et l'innovation. Cette élite marchande et
financière appréciait le prestige des charges publiques, mais n'en dépendait pas directement sur le plan économique.
Elle réussit donc à s'intégrer dans la bourgeoisie élargie du XIXe s. plus facilement que les familles patriciennes,
dont l'adaptation fut plus rude.
- Composition sociale et système de valeurs.
Si la langue française distingue le bourgeois, membre d'une certaine classe sociale, et le citoyen, le terme allemand
de Bürger recouvre ces deux sens depuis la période de la Révolution française, d'où une certaine confusion. Néanmoins
le mot Bürgertum, introduit vers 1850, correspond à bourgeoisie en français et à middle classes en anglais (classe
moyenne et supérieure, économiquement et socialement privilégiée). Sociologiquement, la bourgeoisie regroupe une
grande diversité de métiers, situations économiques et sociales, orientations intellectuelles, culturelles et
politiques. Définie à l'aide de critères objectifs (activité professionnelle, formation), elle rassemble une
bonne partie des commerçants et artisans indépendants, le patronat, les professions libérales (médecins,
avocats, artistes), les hauts fonctionnaires, les cadres et les personnes vivant de leurs rentes, soit 16% de
la population active en 1888 et 1910, et 18% en 1990 (moins d'indépendants, mais plus d'employés). Cependant,
la bourgeoisie était et reste bien davantage qu'un ensemble de groupes sociaux privilégiés par la fortune,
l'indépendance économique ou la formation. Un métier où l'on est à l'abri des travaux pénibles, de bons revenus,
une certaine fortune, une belle situation, une aisance matérielle ne suffisent ni au XIXe s. ni au XXe pour en
faire partie.
Ces groupes sociaux ne pouvaient se transformer en une classe consciente de valeurs communes et même prête à
agir pour les défendre, qu'en développant un genre de vie, une mentalité bourgeoise (non figée), une idée de
la bourgeoisie dépassant les particularités de groupe. Ce modèle culturel, admettant certes des variantes,
mais dans le fond assez contraignant exigeait, au-delà des conditions matérielles, un style semblable dans
la vie domestique, le logement, l'habillement, la nourriture, les rituels quotidiens, mais aussi à l'égard
des loisirs, de la consommation et du luxe. Il comportait tout un système de valeurs: efficacité, succès,
application, travail, sens du devoir, professionnalisme. Il se fondait sur un comportement rationnel, sur
l'individualisme et la responsabilité personnelle, sur l'indépendance de jugement, mais accordait aussi
beaucoup d'importance à la famille et au partage des rôles selon le sexe. L'épouse et les filles d'un
bourgeois n'avaient pas d'activité lucrative: cette convenance, l'une des plus nettes et des plus visibles,
démontrait l'aisance relative du ménage et permettait à la fois de se démarquer des Classes moyennes où les
femmes participaient au commerce, et de se rapprocher d'un genre de vie distingué. La bourgeoisie tenait en
haute estime les sciences, la littérature, les arts, la musique, la culture en général. Les femmes jouaient
là un rôle de premier plan. Même si elles devaient habituellement se limiter à une approche passive (théâtre,
concerts, expositions) ou à une pratique en amateur, elles déterminaient souvent, par leurs choix, le niveau
culturel de la famille.
La culture, les codes du quotidien, l'esthétisme, le bon goût, le respect pour la formation, pour la science
et pour les valeurs supérieures créaient à la fois une distance sociale et une identité. Base des relations
sociales dans la bourgeoisie, ces valeurs permettaient à cette classe de se distinguer des autres et favorisaient
sa cohésion malgré les petites différences qu'elles mettaient en évidence en son sein ou entre grands et petits
bourgeois. Réunions et sociétés jouaient un rôle particulier pour l'identité culturelle et politique. Le bon goût,
les valeurs et les codes ne symbolisaient pas seulement une situation déliée des contraintes économiques, mais
contribuaient aussi à définir la conscience de classe de la bourgeoisie, puisqu'ils lui servaient à se distinguer
de la classe ouvrière. A ses idéaux d'individualisme, de moralité et de culture, la bourgeoisie opposait la masse
nivelée, le prolétaire prisonnier de ses intérêts matériels, d'une moralité douteuse, superficiel, prêt à manquer
à ses devoirs et à ses responsabilités, ignorant, mal formé, inculte en un mot.
- Bibliographie
La bourgeoisie au Moyen Age et à l'époque moderne :
-K. Messmer, P. Hoppe, Luzerner Patriziat, 1976
-Peyer, Verfassung
-B. Mugglin, Olten im Ancien-Régime, 1982
-LexMA, 2, 1005-1041
-Braun, Ancien Régime
-K. Schreiner, «Die Stadt des Mittelalters als Faktor bürgerlicher Identitätsbildung», in Stadt im Wandel, cat. expo.
Brunswick, éd. C. Meckseper, 4, 1985, 517-541
-E.J. Beer et al., éd., Berns grosse Zeit, 1999
La bourgeoisie aux XIXe et XXe siècles :
-M. Riedel, «Bürger, Staatsbürger, Bürgertum», in Geschichtliche Grundbegriffe, éd. O. Brunner et al., 1, 1972, 672-725
-U. Blosser, F. Gerster, Töchter der guten Gesellschaft, 1985
-M. König et al., Warten und Aufrücken, 1985
-H. Siegenthaler, «Die Schweiz 1850-1914», in Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 5, 1985, 443-473
-E. François, éd., Sociabilité et société bourgeoise en France, en Allemagne et en Suisse, 1750-1850, 1986
-G.A. Craig, The triumph of liberalism, 1988
-S. Brändli et al., éd., Schweiz im Wandel, 1990
-H. Siegrist, «Ende der Bürgerlichkeit?», in Geschichte und Gesellschaft, 20, 1994, 549-583
-F. Walter, La Suisse urbaine, 1750-1950, 1994
-D. Joye et al., Les structures sociales de la Suisse, 1995
-A. Tanner, Arbeitsame Patrioten - wohlanständige Damen, 1995
-Ph. Sarasin, La ville des bourgeois, 1998 (all. 21997)
-M. Hettling, Politische Bürgerlichkeit, 1999
BARLATEY -
BELLON -
BERRUT -
BOITZY -
DONNET-MONAY -
FORNAGE -
MARCLAY -
MEYER -
MEYTHIAZ -
MORISOD -
PARVEX -
RABOUD -
RIONDET -
ROSSIER -
ROUILLER -
VOISIN -
VUILLOUD -
BARLATEY
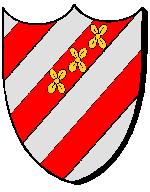
Barré de gueules et d'argent de 6 pièces, les barres de gueules chargées chacune, en chef, d'une quartefeuille d'or.
Sceau moderne, inspiré par les armes des Barratey de Savoie qui sont : barré de gueules et d'argent de 6 pièces,
au chef de gueules chargé de 3 roses d'or (sceau du XVIIIe siècle). Devise des Barratey de Savoie : A tout devoir
fidèle (communication de l'Académie chablaisienne et de la famille de Monthey). Cf. Armorial valaisan, 1946, p22.
Ballatier 1537, Barlatery 1544, Barlattey 1623, Barlatey 1656, Barlathay 1689,
Barlatay 1701, Barlatthey 1727, Barlattay 1825; nom de métier : barlatier, colporteur et
marchand de tout (Académie chablaisienne, XXXII, 117). En Savoie, spécialement en Chablais, existent des familles
de même nom : Barratey, Barathay; Joseph Barathay (1794-1882), soldat de la Brigade de Savoie, prêtre 1821,
curé de Duingt 1826. La famille de Monthey, peut-être originaire du Chablais, apparaît au XVIe siècle. Pierre,
d'Outre-Vièze, est témoin avec Claude Guerrat au mariage de noble Pantaléon de Châtillon-Larringe avec noble
Françoise Jaquin de Bex, le 4 février 1537; Pierre, probablement le même, vice-sautier 1544; Maurice, d'Outre-Vièze,
cité comme bourgeois de Monthey 1656; Claude, d'Illiez, mort 1689 au service de la France. La famille donne à Monthey
de nombreux syndics : Claude 1623, Pierre 1656, Maurice 1665, Antoine 1689, Henri 1691-1692, Jean 1701, Guillaume 1704,
Amédée 1743, Antoine 1751-1752, Amédée 1755, Jean-Pierre 1780, Pierre 1794, Jean 1795, 1798. Claude, procureur de
l'Eglise avant 1794. Jean-Pierre président de Monthey avant 1825. Cyprien (1821-1891), avocat et notaire, président
du Tribunal du district de Monthey 1857-1877, juge au Tribunal d'appel 1857-1877, puis à la Cour d'appel et de
cassation 1877-1891, député 1852-1857, 1869-1873, conseiller aux Etats 1869-1871, président de Monthey 1853-1856.
Une branche de la famille fait souche à Collombey au XVIIe siècle.
BELLON
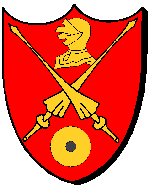
Bellung 1615; ancien prénom du XIIIe siècle (cf. Gremaud, I, 264). Des familles Bellon sont citées en Savoie
à Annecy, à Thônes, à Chamonix, dans la vallee d'Aulps; de cette vallée une branche aurait passé dans celle
d'Illiez, à Troistorrents, où figure Louis Bellung en 1615; Pierre Bellon, procureur de l'Eglise 1725. Claude
est cité comme ancien syndic de Choëx en 1789.
BERRUT
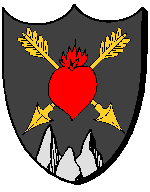
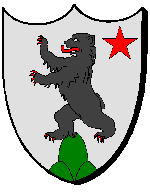
Vieille famille de Troistorrents qui a donné des ecclésiastiques et des magistrats locaux. Michel et
Antoine Berrut figurent parmi les représantants de Troistorrents qui reconnaissent l'autorité valaisanne en
1956. Claude, notaire cité de1610 à 1637. on mentionne Jeannette, épouse de Jean de Montheolo, en 1617.
Claude, ordonné prêtre en 1633, Dr en théologie, curé de Muraz 1634, recteur à Troistorrents 1680,
administrateur de la paroisse de Collombey et aumônier du couvent 1681, t 1685; Jean-Joseph, chanoine
de l'Abbaye de Saint-Maurice, recteur de l'Hospice Saint-Jacques 1724- 1731; Jean-Louis, curé de Collombey
1759-1790, aumônier du couvent, t 1810. Le patronyme se rencontre sous les formes Berut, Berrut, Berru,
Berrutti; des branches de la famille portent les noms de Berrut-Berthoud et de Berrut-Maréchal.
BOITZY
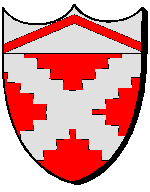
Bueys vers 1300, ly Bues 1350, dou Vuecy 1350, de Vuets, Boys 1487, Boy, Boysius, Boiceus, Boytius 1657, Boychiz 1639,
Boysi 1659, Boijocis 1659, Boissy, Boissi, Boichi, Boichir 1757, Boichy 1802, Boyty 1692, Boity 1846, Boitzi Boitzy;
nom indiquant le voisinage d'un bois, d'une forêt. Famille de Troistorrents, où paraissent en 1350 Perret ly Bues et
Perronet dou Vuecy, qu'on dit remonter à Jean Bueys de Vouvry vers 1300, lui-même fils d'un Bossonet habitant
Saint-Maurice, où des Bochi ou Bochy sont cités dès 1245, peut-être dès 1214, et jusqu'en 1350. Pernet Boys, de
Perréaz, témoin à Monthey 1487. Jean Boychiz, de Collombey, épousa Pernone Charléty et fut père d'un Jean vivant
en 1639. A Troistorrents la famille a cédé des vignes et fait des donations en faveur de l'Eglise; plusieurs de
ses membres servirent la communauté comme notaires, procureurs, syndics, testamment: Claude Ier Boysi ou Boijocis,
notaire 1655-1688; Claude II Boyci, Boysius, Boyty, notaire 1674-1693; François Boichir, syndic 1757; Gabriel
(1899-1966), député 1941-1949. La famille a donné plusieurs ecclésiastiques: Joseph-Antoine (1895-1943)
rédemptoriste, missionnaire au Pérou; Alexandre (1896-1965) rédemptoriste; Jean, né 1905, chanoine de
Saint-Maurice; André, né 1910, rédemptoriste.
DONNET-MONAY
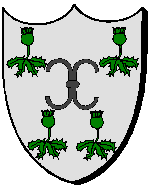
Branche de la famille Donnet qui a ajouté à son patronyme primitif le nom de Monay sans doute à la suite d'une
alliance avec la famille de ce nom. La famille Donnet-Monay apparaît comme telle antérieurement à 1800 et figure en
même temps comme famille bourgeoise de Troistorrents. D'argent à une anille de moulin dle sable accompagnée
de 3 châtaignes dans leur bogue (le sinople tigées et feuillées du même, posées 2 en chef et 1 en pointe.
Vitrail à l'église de Choëx 1970. Communication de M. J. Marclay Monthey. 1972. Les rameaux de châtaignier
apparaissent comme une variante des armes Donnet; l'anille de moulin évoque le nom Monay (voir ce nom).
FORNAGE
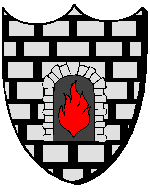
Fornay, Fornaio, Fornaion, Fornaioz, Fornazo, Fornajoz, Fornageoz, Fornagier, nom dérivé defornarius :
celui qui cuit le pain au four. Famille de Troistorrents. Jordan, de Mellijon, fait une reconnaissance
en faveur du duc de Savoie 1457 (Archives de Monthey, D, 56); ses fils Claude et Henri font de même 1487
(ibid., D, 101); Jordan, Jean et François sont parmi les représentants de Troistorrents, qui reconnaissent
l'autorité du Valais 1536; Antoine, de Mellijon, syndic de Troistorrents 1560; la bourgeoisie de Monthey alberge
à Thomas, de Troistorrents, les moulins du Pas 1588; Claude, syndic de Monthey 1597; François, maître d'école
à Saint-Maurice 1632; Claude-Balthazar, de Troistorrents, recteur de la chapelle des Paërnat à Monthey 1721,
mort 1745; Jean-Joseph, des Neyres, fait un legs à l'hôpital de Monthey 1757; Jean-Claude, procureur des Neyres,
prit part à l'assemblée du 3 octobre 1790 chez les de Lavallaz à Collombey en vue de l'émancipation bas-valaisanne;
Jean, syndic de Troistorrents 1838.
JUILLARD
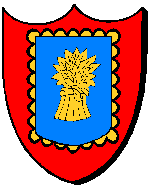
Famille bourgeoise de Troistorrents, dont le nom dériverait du prénom Jules ou Julius, d'où Juliard, Juillard (A. Dauzat: Les noms
de familles de France, Paris, Payot, 1945, p. 125; F.Fenouillet: Les noms de famille en Savoie, Académie chablaisienne, XXXII, p. 80).
Tamini et Délèze (Essai d'histoire de la vallée d'llliez, Saint-Maurice, 1924, p. 77) pensent qu'on peut identifier ce patronyme avec
celui de Juglard qui paraît avec Jean Juglard, de Chièzes, en 1418, mais ce rattachement n'est pas établi. Jean Julliard alias Grand
est notaire en 1520, de même Claude Julliard alias Grand en 1568; Claude Julliard alias Thurchod, notaire en 1650, procureur
d'église en 1651; Jean-Pierre Juillard ou Juillardi est recteur à Troistorrents en 1675, puis curé de Saillon 1679-1696; Pierre,
notaire, châtelain abbatial de Chièzes 1710-1720.
MARCLAY
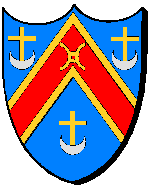
Le nom de cette famille a beaucoup varié: de Marclesio 1388, de Marcleys 1390, de Marclesy 1427, Marclesii 1481,
Marclesi 1536, Murcley 1560, Mairclay 1624, Marclesius 1685, Marclei 1727, Marclaz 1765, Murtlezy 1800, Marclat,
Marcloy Famille originaire de Marclay, hameau de la commune de Bons, en Chablais, près de Thonon, fixée à Illiez
au XIVème siècle. Qualifiée Noble et portant particule, la famille Marclay ou de Marclesy possédait
le patronat de l'autel des Sainis Jean et Barthélemy à l'église d'Illiez et y avait son caveau. La famille a
donné de nombreux notaires, syndics, châtelains curiaux, métraux ecclésiastiques. Aux XVème et
XVIème siècles on rencontre une famille Premand alias Marclesy ou Marclesy alias Premand (voir ce nom),
qui est sans doute une branche de la famille Marclay ou une famille apparentée Louis (1602-1657), notaire,
châtelain 1641-1644 et 1649-1652, laissa trois fils: Jean (1629-1677), Barthélemy (16311697) et Angelin (1648-1736),
qui furent reçus Libres Patriotes par la Diète valaisanne en décembre 1671; Jean et Angelin furent officiers au
service de France et obtinrent le commandement d'une compagnie du Régiment de Courten qui resta dans leur famille
de 1671 à 1746; quant à Barthélemy, il fut notaire, curial, châtelain d'Illiez 1669-1670, 1673-1681, 1687-1696, et
offrit les retables du maître-autel (1672) el de l'autel des Saints Jean et Barthélemy (1673) de l'église d'Illiez.
Jean-Grégoire (1772-1815), notaire 1795, membre du Conseil provisoire de gouvernement de Monthey 1798, curial 1800,
vice-président du district 1803, syndic d'Illiez 1804, juge suppléant au Tribunal suprême 1805, geocal 1809,
châtelain d'liliez 1809, président d'liliez 1810 visegrand-châtelaindu dizain 1809-1810, député à la Diète
valaisanne 1809-1810, notaire impérial 1813.
Adrien(1792-1860), notaire, grand-châlelain, dépuic, président de Champéry 1845-1856;Emmanuel, présidenl 1897-1904;
Grégoire, président 1925-1948. Isaac (1865-1927), notaire, avocat, juge-instructeur 1901-1905, juge à la Cour d'appel
1905, qu'il préside 1906, puis au Tribunal cantonal de 1908 à sa mort; Jean, né en 1904, fils du précédent, chimiste,
héraldiste, collaborateur de l'Armorial valaisan de 1946 et du présent armorial. Robert, né en 1920, fils de Grégoire
qui fut président de Champéry, est Dr ès lettres, professeur à l'Ecole de français moderne qui est une section de
l'Université de Lausanne 1954, directeur de cette section 1969, professeur extraordinaire à la Faculté des lettres
de ladite université 1973.
Un rameau de la famille se fixa à Saint-Maurice au XVIIème siècle et y fut reçu bourgeois ;
Jean-François 16961754), hôte de l'Ecu du Valais à partir de 1722, maître des Postes, syndic de la ville
1733-1738, allié à Marie-Barbe Jossen (t 1757); leur fille Marie-Catherine épouse en 1745 Eugène-Hyacinthe
de Nucé (1721-1775) à qui elle transmet la ferme des Postes qui restera dans leur descendance.
La famille est bourgeoise des communes de Val-d'Illiez, Champéry, Troistorrents; une branche
d'Illiez a été agrégée à Monthey en 1832 et un rameau de Champéry à Lausanne en 1956. La famille a laissé de nombreux
documents héraldiques, avec des armes variables.
MEYER
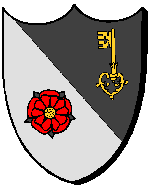
Tranché au I de sable à une clé d’or posée en pal ; au II d’argent à une quartefeuille de gueules boutonnée
d’or et barbée de sinople.
Famille originaire d'Ulm (Württemberg, sud de l'Allemagne) établie à Collombey où Jean-Léonard (Johannes
Leonhard Mayer), maître serrurier, est reconnu habitant perpetuel. Son fils Ernest Meyer, habitant Muraz, devient
valaisan et bourgeois de Collombey-Muraz en 1871.
MEYTHIAZ-MEITHIAZ
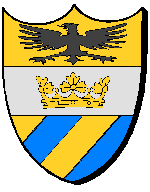 Mettyat, Metyat, Mettiat, Mettiaz, Metiaz, Metias, Methias, Methyaz, Methiaz
Mettyat, Metyat, Mettiat, Mettiaz, Metiaz, Metias, Methias, Methyaz, Methiaz
Jean de Vantéry voit dans ce nom l'équivalent de Meizo, Meyzo, Meyzoz, dérivé lui-même de medicus, le meije ou
meidze en dialecte. Famille de Troistorrents qui remonterait au XIVe siècle, éteinte 1940. Jeanne, fille de
Guillaume, épouse (1522) Jacques de Fonte, syndic d'En-Bas à Monthey 1529. Claude, syndic de Troistorrents 1678;
Daniel, syndic de Troistorrents 1718; Claude, syndic de Troistorrents 1733; Jean, recteur de Sainte-Barbe à Sion
1783-1788; Pierre-François, de Properey, major en France sous la Révolution 1792, commandant de place à Aigle 1798,
lieutenant-général, mort 1799 en Egypte alors qu'il participait à I'expédition de Bonaparte; Jean-Claude, du Pont,
commandant en France, chevalier de la Légion d'honneur, mort 1845 à Pontarlier. Un membre de la famille se fixa à
Loèche au XIXe siècle sans y laisser de postérité.
MORISOD
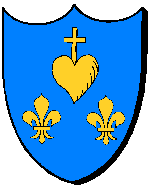
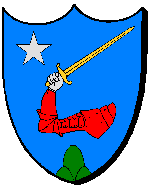
Le nom de cette famille est un dérivé du prénom Maurice dont A. Dauzat (Les noms de familles de France, Paris,
Payot, 1945, p. 104) signale plusieurs variantes, entre autres: Moris, Morize; de même F. Fenouillet
(Les noms de famille en Savoie, Académie chablaisienne, XXXII, p. 81): Moris, Morisset, Morrisson, Morizet,
et C. Rust (Annales valaisannes, 1945, p. 451): Moris, Morissod, Murissod. Vieille famille de la vallée
d'Illiez qui, selon J.-E. Tamini et P. Délèze (Essai d'histoire de la vallée d'Illiez, Saint-Maurice, 1924, p.78),
«remonte probablement vers 1350» et à laquelle ces auteurs rattachent (p. 58) Martin Murys, familier de la Cour
des seigneurs du Vernet, de Saint-Germain, de Nernier et d'Arbignon à Illiez en 1392; ainsi que Humbert Maurice
d'Evouettes d'Illiez, notaire et curial d'Illiez en 1505. Aymon Morisod figure parmi les représentants de
Troistorrents qui reconnaissent l'autorité valaisanne en 1536. Jean-Théodore, de Troistorrents, est curé de
Vionnaz de 1727 à 1736.
La famille a essaimé dans toute la région et a acquis droit de bourgeoisie avant 1800 à Monthey, Massongex et
Vérossaz; un rameau de Monthey a été agrégé à Genève en 1921, de même que des rameaux de Vérossaz à Versoix (Genève)
en 1929 et à Genève en 1960; un rameau de Massongex a été admis à Montreux en 1962. Un Louis Morsoud, reçu bourgeois
de Saint-Maurice en 1780, se rattachait sans doute à une branche de la famille Morisod.
PARVEX
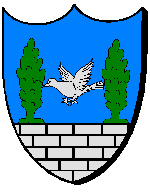
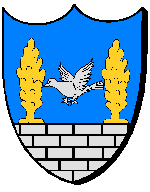
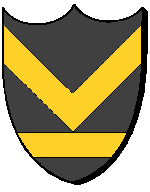
D'azur à 2 peupliers de sinople issant d'une mu-raille d'argent, maçonnée de sable, occupant la pointe ; entre les peu-pliers,
en chef, une colombe volante d'argent.
Communication de M. John Baud, Académie chablaisienne, à la famille. Variante: les peupliers d'or.
De sable au chevron versé d'or soutenu d'une fasce abaissée du même.
Ancienne marque de famille qui ferait jeu de mots par Ve soit Parvex. Cf. Armorial valaisan, 1946, pp. 190-191.
Parvet, Parveti, Parvé, Parvex, Parvey, Parvez ; probablement dérivé de parvus, parvulus, petit. Ancienne famille bourgeoise de
Collombey-Muraz et, autrefois, de Monthey, qui se rattache peut-être à Pierre et Anselme Parvel, de St-Triphon, cités vers 1231-1232.
Pierre Parvet, mentionné 1427, épouse Jaquemette de Lolomont (de l’Olomont, de Lalomont, Delalomont, Delolomont, famille de Muraz
et Monthey) dont il eut un fils, Nicod ; Jean, notaire, 1449 ; Jean, petit-fils de Pierre, épouse Marguerite de Neuvecelle (morte avant 1551),
d’Aigle, est notaire, maître es-lois, châtelain de Monthey pour le duc de Savoie 1510-1511, secrétaire du juge de Monthey 1517-1524,
lieutenant du juge 1525-1535, secrétaire du gouvernal 1536-1538 ; François, fils du précédent, notaire, curial du château de Monthey
1556-1564, épouse Hippolyta de Nucé ; Guillaume, cité comme bourgeois de Monthey 1575 ; Me Claude, bourgeois de Monthey,
syndic 1714, fonde une messe au rectorat de l’hôpital 1717 ; Joseph, fils d’Antoine, syndic de Muraz, prieur de la Confrérie du
Saint-Sacrement 1751-1754, syndic bourgeoisial 1762, encore mentionné en 1787 comme ancien syndic de Collombey-Muraz ;
Michel, syndic d’En-Bas à Monthey-Collombey 1762 ; Antoine, syndic de Muraz 1776 ; Joseph, agent recenseur 1798, châtelain
de Collombey-Muraz 1803 ; Jean-Didier, notaire, 1834 ; Norbert, président de Collombey-Muraz 1853 ; Jean-Didier (1864-1939),
député 1933-1937 ; Georges, né en 1927, avocat-notaire, député 1965-1969.
RABOUD
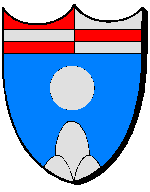
D'azur au besant d'argent accompagné en pointe de 3 coupeaux du même, au chef parti de gueules et d'argent
à une fasce de l'un dans l'autre.
Collection de Riedmatten qui attribue ces armes à la famille de Vionnaz. Variante: le chef entier de gueules
à la fasce d'argent et pas de coupeaux en pointe. Collection de Riedmatten. Cf. Armorial valaisan, 1946,
p.204 et pl.40.
Robbodi, Rabbodi, Rabodi, Rabbod, Rabod, Rabbo, Rabboz, Rabboud ; de l’ancien
prénom Regiboldus ou Riboldus, Rabbold, Rabo. Famille de la région de Monthey qui apparaît avec
Claude Robbodi en 1485, Vouterus Rabbodi de Perey en 1486, et Jean Rabboud, de Chésaux,
mort avant 1487, date où sa fille Jacquemette épouse Claude Oudran, habitant Perréaz, fait une reconnaissance
en faveur du duc de Savoie à Monthey (Archives de Monthey, D, 97). Bernard Rabod, vicaire amodiataire de
Troistorrents 1501-1537 ; Antoine, représentant de Troistorrents lors de la dédition de 1536 ; Claude,
châtelain de Chièzes 1562 ; Claude, syndic de Troistorrents 1643 ; Jean, syndic de Troistorrents 1647 ;
ses filles Jeanne et Louise se marient le 2 janvier 1647 avec les frères Pierre et Louis de Monthey ; Pierre,
syndic de Troistorrents 1699 ; Joseph, de Chemex, châtelain de Troistorrents 1801. Claude, fils de Claude, reçu
bourgeois de Monthey 1789. Jean-Louis de Choëx, syndic de Monthey 1818 ; Adrien, de Choëx, vice-président de la
bourgeoisie de Monthey 1889-1894 ; Jean, vice-président de la même bourgeoisie 1903-1904, ainsi que Clovis
1912-1916. Une branche existe à Vionnaz (et Illarsaz) où Jean-Joseph est syndic 1673 ; Elisabeth, de Vionnaz,
épouse Nicolas Revenger de Bompré, lieutenant-colonel au service d’Espagne, mort 1801 à Sierre ; d’autres
branches sont signalées aussi à Martigny, où Michel est syndic 1699, Saint-Maurice (XIXe siècle) et Riddes. Théophile
(1909-1973), directeur de banque.
RIONDET
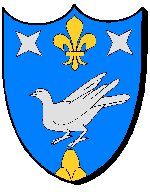
D'azur à la colombe d'argent posée sur un mont de 3 coupeaux d'or et surmontée d'une fleur de lis aussi d'or entre
2 pointes de diamant d'argent.
Cf. Armorial valaisan, 1946, p.213. Armorial des Familles bourgeoises de Saint-Maurice, 1971.
Le nom, qui s'écrivit aussi Ryondet, dérive de riond, forme dialectale du vieux français réond, rond. Famille originaire
de Properaz (Troistorrents), citée dès le XIVe siècle; elle s'est répandue à Monthey où elle donne des syndics au XVIe
siècle et s'allie aux Du Fay. Une branche s'établit à Sion au XVIIe siècle et Joseph est reçu bourgeois de Chamoson en
1722. Dans ses diverses branches la famille a donné des notaires, magistrats et ecclésiastiques.
Louis Riondet, forgeron, est admis le 5 novembre 1493 à la bourgeoisie de Saint-Maurice où il habite (20 sols mauriçois).
La famille est encore représentée dans cette ville au XVIIe siècle. Des branches de la famille sont encore bourgeoises
de Troistorrents, Collombey-Muraz, Grimisuat, Genève (1938), Thônex (Genève) (1954).
ROSSIER
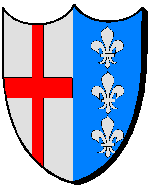 Famille de Troistorrents (district de Monthey) qui apparaît avec Jean
Famille de Troistorrents (district de Monthey) qui apparaît avec Jean
Rossieri en 1350. Jean Rossery "de Fribor de Macherel", prieur de la Confrérie du Saint-Esprit en
1389, est du quartier appelé Fribor dans le hameau de Macherel ou Macherex.
Le patronyme se présente ensuite sous les graphies Rosserii en 1568, Rosseri 1577, Rossyer
1681. On cite: Pierre, vicaire amodiataire de Troistorrents 1568-1573, curé de Collombey 1577; Jérôme, notaire,
1590; Jérôme, notaire, 1718.
ROUILLER
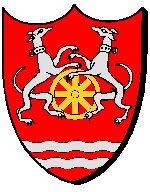
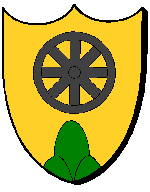
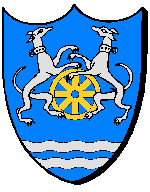
Famille notable de Troistorrents, dont le nom a passé par les formes suivantes : Rollieri
1332, puis Rolier, Rollier, Rolyer, Roullier, Rouillier, Rouiller.
Cette famille apparaît dès 1332 et donne plusieurs magistrats et ecclé-siastiques, notamment : Louis, chanoine de Sion 1567, curé de Saillon 1572, t 1587;
Ignace (1799-1869), recteur de Champéry 1831, curé de Muraz (Collombey) 1841; Hyacinthe (1841-1916), chanoine de
Saint-Maurice, curé de Vérossaz 1874, procureur de l'abbaye 1886, recteur de l'Hospice Saint-Jacques 1908;
Séraphin (1884-1958), curé de Muraz 1910, de Yex 1915, doyen 1920, curé de Saint-Pierre-de-Clages 1948; Alexis,
né en 1922, chanoine de Saint-Maurice, Dr en théologie, prêtre 1948, professeur, premier curé de Verbier 1962,
où il construit l'église du village; Grégoire, frère du précédent, né en 1925, prêtre 1954, professeur à la Faculté
de théologie de l'Université de Fribourg 1966.
La famille s'est ramifiée dans la région, notamment à Monthey, dès le XVIIe siècle, et à Saint-Maurice où s'établit
Jean, fils de Pierre; capitaine au service du Piémont, il épouse en 1730 Anne-Catherine Gallay et fut reçu bourgeois
en 1744; il est l'auteur d'une branche éteinte au XIXe siècle, qui donna, notamment: Hyacinthe (1736-1798), capucin
sous le nom de père François-Joseph, prédicateur à Sion 1766-1767, prit une part active à la séparation des couvents
du Valais d'avec la Province de Savoie et à leur rattachement à la Province de Suisse, puis lecteur de théologie à
Fribourg, transféré ensuite au couvent du Marais à Paris, aumônier à la Cour du prince de Holstein-Limbourg, candidat
à l'épiscopat, eut des difficultés à Rome où il fut assigné à résidence dans le couvent des Saints-Anges, mort dans
un couvent de Toscane; Joseph (1751-1818), officier au service de France, survécut au massacre des Tuileries le 10
août 1792, plus tard, sous l'Empire, colonel des-dragons en Vendée, secrétaire du département du Simplon 1811,
préfet du département de la Doire (Aoste) 1813, mort à Angers; Joseph, fils du précédent, jésuite, professeur à
l'Université de Louvain.
Des branches de la famille de Troistorrents portent les noms de Rouiller-Monay et Rouiller-Souhier. Un rameau de
la famille Rouiller de Troistorrents a reçu droit de cité à Lausanne en 1962.
VOISIN
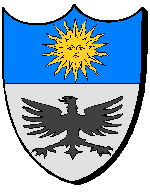
Coupé : au 1 d'azur au soleil figuré et rayonnant d'or ; au 2 d'argent à l'aigle éployée de sable. Variante :
l'aigle becquée, languée et membrée de gueules. Autre variante : le coupé remplacé par un chef.
Famille répandue dans les vallées d'Abondance et de Bellevaux en Chablais (Haute-Savoie), et qui a essaimé dans
le district de Monthey, où des familles de ce nom apparaissent dans le recensement de 1829 à Collombey-Muraz.
Les Voisins, "habitants perpetuels" à Muraz, furent naturalisés et admis à la bourgeoisie de Collombey-Muraz en 1872
avec Florentin et Maurice.
VUILLOUD-WUILLOUD
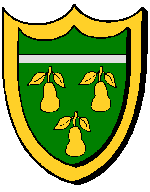
De sinople à 3 poires d'or, tigées et feuillées du même, posées en barre, rangées 2 et 1, surmontées d'une trangle
d'argent, le tout entouré d'une filière d'or.
D'Angreville, 1868; Armorial valaisan, 1946, p.288 et pl.40; peinture à l'Hôtel de Ville de Saint-Maurice, 1971; armorial
des Familles bourgeoises de Saint-Maurice, 1971.
Variante: sans la filière: monument funéraire d'Emile Vuilloud, 1889, au cimetière de Monthey. Ces armes évoquent l'origine
de la famille et son nom primitif, de Pratopiri: pratum piri, le pré du poirier. Cimier: un poirier.
Cette famille fut d'abord appelée Prauperey, Properey, Praupery, en latin de Pratopiri, nom d'un hameau de la paroisse de
Troistorrents, aujourd'hui Propéraz, d'où la famille tire son origine. En 1329 paraît Rodolphe, fils de Jean de Pratopiri;
Perrod, fils d'Aymonet, reconnaît en 1352 tenir du comte Amédée VI de Savoie 5 pièces de terre à Massillon au dessus
de Monthey; Jeannet et Genier font aussi en 1404 une reconnaissance en faveur de l'église de Collombey dont la
paroisse comprend Monthey. Guillaume est reçu bourgeois de Monthey le 8 avril 1435. Le nom actuel apparaît à la fin du
XVe siècle avec Perrod Vuilloud alias de Partopiri, fils de Guillaume de Partopiri et Martine Vuilloud, vivant en 1458;
avec Antoine de Properey alias Vulliod, puis avec Claude Wuilliodi, notaire, curial de Monthey en 1525.
Ce nouveau nom qui deviendra définitif, passe par de très nombreuses variantes, entre autres : Villod, Villiod, Vullioud, Wouilloud.
La famille donne des magistrats locaux, notamment : Jean-Michel, syndic des quartiers d'En-Bas 1728-1729; Jean, syndic de
Monthey 1739-1740; Pierre-Maurice, syndic de Collombey 1787-1791; Hyacinthe-Antoine, Dr médecin de l'Université de
Montpellier 1792, grand-châtelain de Monthey 1802-1810 et 1815-1832; Jean, syndic de Monthey 1817; Frédéric,
vice-châtelain 1834; Gustave, vice-président du dizain 1845-1848. A l'époque moderne, la famille est plusieurs fois
représentée dans les Conseils. Emile (1822-1889), de Monthey, est architecte, géomètre, peintre, musicien, professeur
de dessin au Collège de St-Maurice, conseiller municipal de Monthey 1855-1859; il construit les églises de Monthey,
Collombey, Aigle, Vevey. Jacques, allié à Jeanne-Marie Avanthey, s'établit vers 1718 à St-Maurice, où Jean-François,
petit-fils de Jacques, né en 1752, est cité en 1804 comme ancien syndic; Jean-François, fils du précédent, est vicaire
à Ardon 1826, recteur de Trient 1831, recteur de Vionnaz 1836, de nouveau vicaire à Ardon 1839, décédé en 1879.
Maurice, né en 1917, conseiller municipal 1961-1969, secrétaire bourgeoisial 1961, député au Grand Conseil 1969.
Etienne, allié à Joséphine Penon, fut l'auteur d'une branche établie à Sion. Henry (1884-1963), ingénieur agronome,
Dr ès sciences, oenologue, professeur à l'Ecole polytechnique de Zurich, écrivain, historien, journaliste, propriétaire
du domaine de Diolly sur Sion dont le nom était généralement ajouté à son patronyme. Les branches de Monthey et
St-Maurice ortographient aujourd'hui leur nom Vuilloud, celles de Collombey-Muraz et Sion Wuilloud. Un rameau de
Collombey, écrivant Vuilloud, a obtenu droit de cité à Genève en 1929.
Source : DUPONT-LACHENAL (L.) et WOLFF (A.): Armorial Valaisan. Sierre-Sion, Ed. à la Carte, 1997. reprint de
l’édition de 1946. 1 vol. 304 pp avec 40 planches. (Extrait concernant les bourgeoisies de Troistorrents et
de Collombey-Muraz)
|
