|
La quatrième coalition
(1806-1807)
I - LA COALITION
C’est à peu près la continuation de la précédente coalition, avec la substitution de la Prusse à l’Autriche et l’accession de la Suède. Les raisons à invoquer ne manquaient pas à la Prusse pour engager une lutte où elle était déjà prête à entrer à la veille d’Austerlitz : violation du territoire d’Ansbach et de Baireuth, manoeuvres blessantes de Napoléon au sujet d’un projet de confédération du Nord ; surtout double humiliation du Hanovre, que l’empereur avait forcé la Prusse à accepter à Schoenbrün et qu’il avait été sur le point de lui reprendre pour faire la paix avec l’Angleterre.
Mais la vraie cause de la guerre était surtout l’état d’esprit, non de la nation prussienne, mais du roi et de la cour : Frédéric-Guillaume III à la merci de toutes les influences, la reine Louise exaltée et d’un orgueil héroïque, " Armide mettant le feu à son propre palais ", une aristocratie vaine etfrivole, une armée qui se croyait encore l’armée de Frédéric II, de vieux généraux pleins de confiance en leur science vieillie.
Les péripéties de cette guerre reproduisent celles de la précédente : comme l’Autriche, la Prusse prend une offensive prématurée et est écrasée avant l’arrivée des forces russes. Celles-ci soutiendront plus longtemps la lutte, avec les débris des armées prussiennes, mais seront vaincues à leur tour.
II - NAPOLEON SUR LA SAALE
Les forces prussiennes étaient divisées en deux armées : la première, 75 000 hommes, commandée par le roi Frédéric-Guillaume III, avec le duc de Brunswick ; l’autre, plus faible, 56 000 hommes, sous les ordres du prince de Hohenlohe. Au lieu de se retrancher derrière la Saale ou l’Elbe pour couvrir Berlin, et d’attendre dans une position défensive l’arrivée des Russes, les Prussiens se décident à prendre l’offensive, espérant surprendre la Grande-Armée qu’ils supposent dispersée dans ses cantonnements entre Main et Danube, et la couper de ses communications avec Mayence. Dans ce but, Brunswick vient prendre position dans le Thuringer Wald, à Eisenach, Gotha, Erfürt, pour observer la route de Francfort à Mayence, pendant que Hohenlohe s’étend entre Weimar et la haute vallée de la Saale pour surveiller les débouchés du Franken Wald. Napoléon met leur imprudence à profit : il concentre rapidement son armée, déjà cantonnée, depuis Austerlitz, dans la vallée du Main, la droite à Baireuth, le centre à Bamberg, la gauche au nord de Würzbourg ; avec la réserve de cavalerie de Murat et la garde, il peut disposer de 175 000 combattants. Les Prussiens l’attendant vers le Nord-ouest, par la route de Francfort à Eisenack par Fülda, Napoléon forme le projet de pénétrer en Saxe par la haute Saale, de déborder la gauche des Prussiens, de les couper de Berlin et de les accabler avant l’arrivée des Russes.
Pour maintenir les Prussiens dans leur erreur, Napoléon fait des démonstrations vers la Thuringe, et rassemble ostensiblement une armée à Wesel, sous les ordres du roi de Hollande. Pendant ce temps, la Grande-Armée franchit - 8 octobre - le Franken Wald sur trois colonnes : celle de droite - Soult et Ney - par le col de Baireuth ; celle du centre - Bernadotte et Davout - par le col de Kronach ; celle de gauche - Lannes et Augereau - par le col de Cobourg. La cavalerie de Murat précède les trois colonnes par le col de Kronach pour refouler les avant-gardes ennemies et déblayer les débouchés des cols. La colonne de droite arrive san incident à Hof et à Plauen - 10 octobre - Murat et Bernadotte s’emparent de Saalbourg, et dispersent à Schleitz - 9 octobre - 10 000 Prussiens commandés par Tauenzien ; le 10, Lannes s’empare de Saalfeld après avoir culbuté le corps du prince Louis .
Toute la haute Saale est aux mains des Français. Napoléon concentre ses différents corps à la hauteur
d’Auma, et le 13 vient border la rive droite de la Saale dont il saisit tous les points d’Iéna à Naumbourg, coupant ainsi sa ligne de retraite à l’armée prussienne. Au nord, Dayout, avec 27 000 hommes - occupe Naumbourg, le pont et le défilé de Kösen ; Bernadotte est à Dornbourg, pendant que Napoléon, avec le reste de l’armée, fait face à Iéna et à Weimar pour se rapprocher de hohenlohe établi sur la rive gauche de la Saale. Mais, craignant d’être coupé de ses communications avec Berlin, et voulant avant tout éviter le sort de Mack à Ulm, il prend le parti de se retirer au plus tôt derrière l’Elbe. Le 13 octobre, Frédéric-Guillaume III et Brunswick quittent Weimar pour se diriger sur Naumbourg, laissant à Hohenlohe, renforcé du corps de Rüchel posté à Weimar, le soin de défendre leur retraite en surveillant les débouchés.
Napoléon, croyant l’armée prussienne toute entière réunie sur les plateaux de la rive gauche de la Saale, se dispose à l’attaquer de front à Iéna, pendant que Dabout et Bernadotte viendront la prendre à revers (vers Apolda), en franchissant la Saale, l’un à Naumbourg, l’autre à Dornbourg. Ces dispositions amènent les deux batailles d’Iéna et d’Auerstaedt, livrées le même jour : la première par Napoléon à l’armée de Hohenlohe, la deuxième par Davout à l’armée du roi ; celui-ci complète la victoire de l’empereur en réparant son erreur (14 octobre).
III - LA DEROUTE PRUSSIENNE
Après ces deux batailles, l’armée prussienne, qui devait tout renverser devant elle, n’existait plus. Hohenlohe, qui avait pris le commandement de ce qui restait de troupes prussiennes, cherche à gagner l’Elbe, à réunir les débris de l’armée et à se diriger au nord sur le Mecklembourg, pour atteindre, par un détour, la ligne de l’Oder.
Mais Napoléon lance ses différents corps à la poursuite des Prussiens, de manière à les déborder et, par une marche oblique d’Iéna à Stettin, à les prévenir sur l’Elbe et l’Oder pour s’interposer entre eux et les Russes et empêcher leur jonction.
Hohenlohe, poursuivi par Lannes et Murat, met bas les armes à Prenzlow - 28 octobre ; Blücher, avec 20 000 hommes, atteint par Soult et Bernadotte, capitule à Lübeck - 8 novembre. Les places fortes se rendent sans résistance : Magdebourg, avec 22 000 hommes, ouvrent ses portes à Ney - 8 novembre - Stettin se rend à quelques escadrons du général Lassallle - 29 octobre - Cüstrin à quelques compagnies de l’avant-garde du corps de Davout - 3 novembre.
Le roi de Prusse s’est réfugié à Koenigsberg, il ne lui reste plus que 15 hommes.
Le 25 octobre, l’empereur entre à Berlin où Davout avait eu l’honneur de faire une entrée triomphale avec les héroïques combattants d’Auerstaedt.
La bataille de Iéna
Napoléon harangue ses troupes du haut de la butte d'Iena...
La victoire sera écrasante.
Presque un an après l'éclatante victoire d'Austerlitz, Napoléon a très peur que la Prusse s'engage dans la guerre. Le problème est que ce pays a une très bonne armée, beaucoup mieux encadrée que les armées autrichienne et russe. Cette crainte se concrétise malheureusement, et poussé par son épouse Louise de Prusse, le Roi allemand décrète le réarmement. Partout en Prusse des jeunes gens s'enrôlent, les industries tournent à plein régime. En deux semaines à peine, l'armée est prête, toute fraîche et déterminée. Napoléon réagit et place ses armées à tous les points stratégiques de l'Allemagne ; à Mayence, à Ulm, à Francfort, les français placent leur campement et sont prêts à la contre-offensive. Le 7 octobre, le Roi de Prusse envoie un ultimatum à l'Empereur, le sommant de quitter la Prusse et l'ensemble des Etats allemands de la future "Confédération du Rhin". Napoléon refuse, l'affrontement est inéluctable...
Le 13 octobre, les français se dirigent vers la Saale, et le grand maréchal Lannes met en déroute l'avant-garde allemande, dirigée par le prince Louis-Ferdinand de Prusse qui sera tué au cours de la bataille. Au nord, Davout détruit la moitié de l'armée prussienne à Auerstäedt. Mais Napoléon, maintenant posté à Iéna, ne l'apprendra que le soir du 14 octobre, après la célèbre victoire de Iéna. Celle-ci débuta à 7 heures du matin. Soult, sur la droite, avec sa puissante artillerie, va pilonner les postions prussiennes les obligeant à se replier. Ney se poste en avant-garde et contient les contre-offensives allemandes. Face à lui, le général prussien Hohenlohe, visionnaire militaire de son temps, sait que ses hommes n'ont pas été entraîné, et que la bataille va sûrement être perdue. Messembach, son ami général, le rejoint au moment où la situation devient critique. Les prussiens se positionnent sur le plateau d'Iéna, qui est jugé imprenable. Mais le fantastique coup d'oeil de Napoléon va changer le reste de la bataille. Il observe un vaste champs de raisins bordant tout le plateau. Il décide de faire passer ses hommes et le matériel à cet endroit ; les maréchaux approuvent cette directive, car les vignes cachent les français montant la colline. Oui mais voilà, les canons n'avancent plus dans leur ascension, la pente devient trop raide. L'Empereur joue le tout pour le tout, il décide de lancer l'assaut sans l'aide de l'artillerie. Celui-ci débute à 6 heures du matin, sur des prussiens ébahis et mal réveillés. La victoire est totale, et les derniers régiments qui tentaient de s'enfuir sont pilonnés par l'artillerie ayant finalement réussie à gravir les derniers mètres pendant la bataille.
La bataille d'Iéna a entraîné la capitulation prussienne et engendré le terrible duel : France-Russie...
La bataille d’Auerstadt
(14 octobre 1806)
Bataille de Auerstadt : quatrième coalition, campagne de Prusse
Village au nord du duché de Saxe. Le IIIème corps d'armée français, commandé par le maréchal Davout, inflige à l'armée prussienne - sous les ordres du duc de Brunswick - sa défaite la plus cinglante depuis un demi-siècle.
Pendant que Napoléon, avec le gros de la Grande Armée, rencontre l'aile sud de l'armée prussienne à Iéna, les trois divisions du IIIème corps commandé par le maréchal Davout - environ 20000 hommes - avancent vers le village d'Auerstadt dans la Prusse du sud.
Vers 7h00 du matin, l'avant-garde française, commandée par le général de division Gudin est prise à partie par la cavalerie prussienne du général Blücher. Alors que les Français résistent aux charges prussiennes, Davout s'aperçoit tout à coup qu'il affronte en réalité le gros de l'armée prussienne commandée par le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III en personne.
Faisant preuve d'une incroyable bravoure en même temps que d'un grand sens tactique, le maréchal lance ses trois divisions à l'assaut du village de Rehausen. Les Prussiens, bien que trois fois supérieurs en nombre, doivent se replier.
En essayant de reformer le front prussien, le maréchal Brunswick est mortellement blessé. Le roi de Prusse essaie alors de rallier à lui les régiments qui cherchent à fuir.
Blücher et ses généraux réorganisent l'armée prussienne afin de faire face à la furia française et de couvrir la retraite du roi et de la reine. Vers 12h00, ils parviennent à installer une ligne de défense autour du village de Gernstadt.
Davout lance alors le reste de ses trois divisions, déjà très éprouvées par les combats de la matinée. Dans un élan extraordinaire, les Français bousculent les Prussiens qui perdent pied et se replient, poursuivis par la cavalerie française. La retraite prussienne se transforme en déroute. Tous les bagages du couple royal de Prusse sont perdus.
Les Prussiens ont 10000 tués et blessés. Les Français capturent 3000 Prussiens et 115 canons. Les pertes françaises sont très élevées; les divisions du IIIème corps perdent 25% de leurs effectifs (environ 3000 morts). A un contre trois, Davout a infligé à la Prusse sa plus cinglante défaite depuis 50 ans.
Campagnes de Pologne et de Prusse (1806 - 1807)
Malgré l’écrasement de la Prusse, la guerre n’était pas finie. Napoléon allait la recommencer contre la Russie, secondée par l’Angleterre.
Ne pouvant atteindre l’Angleterre, il cherche à la ruiner en décrétant de Berlin (21 novembre 1806) le Blocus continental, qui doit fermer aux marchandises anglaises, les ports et les marchés de la France et de ses alliés.
Pour réduire la Russie, il cherche, tout en l’attaquant directement sur la Vistule, à lui susciter des ennemis. Le général Sébastiani,, notre ambassadeur à Constantinople, décide le sultan Selim à entrer dans l’alliance française, lui garantissant au nom de l’empereur, l’intégrité de son territoire. Amédée Joubert est envoyé à Téhéran pour négocier avec le shah de Perse la conclusion d’une alliance contre le tsar.
L’empereur, maître du cours de l’Oder, par la reddition de Stettin et de Cüstrin, dirige, dans le courant de novembre, la Grande-Armée sur la Vistule. Murat, qui marche à l’avant-garde, entre à Varsovie le 28 novembre au milieu de l’enthousiasme des Polonais, qui attendent des Français la résurrection1 de leur patrie. Le 19 décembre, l’empereur y entre à son tour. Son armée, forte d’environ 160 000 hommes, se compose des corps de Davout et de Lannes, qui forment la droite ; Soult et Augereau se trouvent au centre ; Ney et Bernadotte à gauche.
Les Russes, au nombre de 120 000, sous Benningsen, ont franchi le Niémen, trop tard, en 1806 comme en 1805, pour sauver leurs alliés dont ils n’ont pu recueillir que les débris.
I - Opérations en Pologne
Les troupes de Benningsen s’étendent sur le Bug et la Narew de Czarnowo à Ostrolenke ; les Prussiens sont à Soldau, sur l’Ukra. C’est le pays compris entre ces trois rivières que Napoléon va leur disputer d’abord. Ce pays est coupé de marécages, et, en cette saison, entièrement détrempé ; il rend difficiles les manoeuvres de la cavalerie et de l’artillerie. L’empereur dit qu’en Pologne " Dieu, outre l’eau, l’air, la terre et le feu, a créé un cinquième élément, la boue ".
Pour déloger l’ennemi de cette position, l’empereur fait adroitement franchir par ses troupes la basse
Ukra (feux de paille humide , 23 décembre) ; le passage réussit après un vif engagement à Czarnowo. Le 26, a lieu une
attaque générale ; l’effort principal porte avec Lannes sur Pulstuk ; en même temps, Davout déloge les Russes de Golymin,
et Ney, à notre gauche, enlève Soldau aux Prussiens ; c’est un triple succès en un jour, bien que Benningsen ait annoncé
à Pétersbourg sa victoire de Pulstuk ; Lannes affirme notre avantage en chassant le reste des Russes de la haute Narew,
à Ostrolenka.
L’empereur se décide à attendre une meilleure saison pour la reprise de la marche en avant. Il établit ses troupes sur le terrain qu’elles viennent de déblayer, de Varsovie et Modlin à Ostrolenka. La lutte, d’ailleurs, n’est pas suspendue ; elle se poursuit même dans toute la largeur de l’Europe. En effet, tandis que Lefébvre, assisté de Chasseloup-Laubat, assiège Dantzig, Jérôme fait le siège des places de Silésie, et le général Sébastiani, envoyé à Constantinople pour décider le sultan à une alliance, met les Dardanelles en défense contre une surprise tentée par l’amiral anglais Duckworth
II - Opérations en Prusse
C’est Benningsen qui reprend l’offensive en fondant sur Bernadotte à notre extrême gauche, pour délivrer Dantzig. Bernadotte soutient le choc à Mohrungen (25 janvier 1807). L’empereur lui ordonne aussitôt de reculer devant les Russes, sur les derrières desquels il se jettera lui-même pour les envelopper entre Dantzig et la Grande-Armée. mais l’ordre de Napoléon tombe entre les mains du général russe, qui évite le piège en reculant lui-même et en se rejetant aussitôt sur la route de Koenigsberg. Napoléon, qui a mis toutes ses forces en mouvement, ne veut pas renoncer à la bataille : elle a lieu à Eylau (8 février). Après cette affreuse mêlée, l’empereur reprend son quartier d’hiver, mais plus au nord, à Osterode, où il emploie ses loisirs aux travaux les plus variés (négociations, journaux, Académie, Opéra, maisons de la Légion d’honneur, etc...).
Lorsqu’enfin Dantzig, que les Russes ont vainement tenté de secourir par la basse Vistule, a succombé (26 mai), Napoléon et Benningsen reprennent simultanément leur marche en avant. La campagne s’achève sur la Passarge, après un combat à Heilsberg (11 juin), par la brillante victoire de Friedland (14 jui, jour anniversaire de Marengo). Cette fois, la victoire était décisive. Les Prussiens abandonnent Koenigsberg et les Russes se retirent derrière le Niémen. Napoléon profite de sa victoire pour faire entrer la Russie dans son système politique en signant avec le tsar le traité de Tilsitt (8 juillet) dirigé contre l’Angleterre et inspiré par es idées du Blocus continental.
La bataille d’Eylau
Murat, cavalier de légende, enleva à Eylau
la plus grande charge de cavalerie de l'Histoire.
L'armée de l'Empereur, après les incroyables victoires de Iéna et Auerstaëdt, prend position sur les terres russes (bientôt polonaises après le traité de Tilsit). Six mois de marches et de regroupements stratégiques visant à détruire l'armée d'Alexandre Ier pour obtenir la paix. Celle-ci, déjà bousculée à maintes reprises, s'est repliée en bon ordre derrière la Vistule. Bennigsen, le commandant en chef des armées russes, a conçu un plan démoniaque, visant à couper l'armée française en deux. Celle-ci d'étend de la Baltique à Varsovie, avec Lannes et Murat en pointe. En décembre 1806, les français ignorent toujours la position réelle de l'ennemi. Ce n'est que par hasard que les éclaireurs du 54ème régiment d'infanterie du maréchal Ney ont repéré les feux des bivouacs russes. Ils ont même découvert que des rescapés prussiens de Iéna et Auerstaëdt (tout de même 10 000 hommes) sont présents pour soutenir Bennigsen et ses troupes. Toute cette armée est maintenant cantonné dans la ville de Preussisch-Eylau...
Napoléon se présente devant l'ennemi le 7 février. La ville est reconquise rue par rue, maison par maison. Les fantassins russes se sacrifient pour permettre à leurs artilleurs de se replier. Le lendemain, seul le cimetière d'Eylau est encore sous la main russo-prussienne. L'Empereur envoie la division du maréchal Augereau, qui encercle le périmètre. Soudain, une tempête de neige éclate, et les pauvres français, aveuglés par les bourrasques, se font décimer par la mitraille russe. L'étau se referme, et les soldats d'Augereau sont obligés de battre en retraite. A quelques kilomètres de là, le reste de l'armée assiste à la mort de leur frères d'armes, impuissants et tristes. Le brouillard se lève enfin, et Napoléon joue ses dernières cartes. Il crie à Murat : "Nous laisseras-tu dévorer par ces gens-là ?". Le fier cavalier ne lui répondit pas, et après concertation avec le général Savary qui a remplacé Lannes blessé, réunit tous les cavaliers disponibles. Pas moins de quatre-vingts escadrons font trembler le sol, plus de 8 000 cavaliers ébranlent la ville ! C'est d'ailleurs la plus puissante charge de cavalerie de l'Histoire. Les ennemis sont écrasés, et battent en retraite. Mais la situation n'est pas finie pour autant : Bennigsen fait donner la Garde Russe et attaque celle de Napoléon. Les cavaliers impériaux, déjà épuisés par la charge folle qu'ils viennent d'effectué, n'entendent pas les appels incessants de l'infanterie française. Soudain, on attend au Nord le canon tonner. C'est le maréchal Ney, qui a parcourut avec ses hommes 79 kilomètres la veille, qui est à présent sur le champs de bataille. Bennigsen donne l'ordre de la retraite. Il s'enfuit à l'aube du 9 février 1807, laissant derrière 20 000 morts et disparus. Napoléon, malgré tout vainqueur, a perdu 12 000 hommes, dont huit généraux. Augereau est blessé durement, et sans l'intervention spéciale du chirurgien Larrey, il serait probablement décédé, suite à ses blessures.
C'est la première grande semi-victoire de l'Empire. La bataille d'Eylau a prouvé que la Grande Armée n'est pas invincible. Les russes se considèrent même comme les vainqueurs dans cet affrontement. Mais la défaite cuisante de Friedland va effacer tous les espoirs ennemis...
La bataille de Freidland
Le 14 juin, Napoléon salue les cuirassiers du 12ème régiment.
Cette charge, menée par le colonel Dornes, sera décisive.
Quelques mois après la sanglante et indécise bataille d'Eylau, Napoléon ordonna à son armée de repasser la rivière de la Passarge. La position acquise alors se révèle capitale pour couvrir le siège de Dantzig que l'Empereur se refuse de laisser derrière lui. Après une résistance de quelques semaines, le port prussien se rend, offrant vivres et munitions à la Grande Armée. Napoléon peut maintenant prendre en main les opérations. C'est plus de 170 000 hommes, en comptant les réserves, qui se portent à la rencontre des russes, très affaiblis depuis Eylau. Ceux-ci se trouvent au nombre de 90 000, avec cents pièces de canon alors que Napoléon en aligne plus de deux cents. La domination française est donc indiscutable, mais il faut se méfier de cette armée russe motivée par des officiers fanatisés et des cosaques particulièrement redoutables. De plus, le général Lobanov est en route avec un renfort de 25 000 soldats et 5000 cavaliers. Le 10 juin, l'Empereur fait manoeuvrer sur l'Alle, où Ney reçoit l'ordre d'attaquer le commandant russe Bennigsen. Napoléon met alors en place un plan très ingénieux, comme à l'habitude : il fait en sorte d'attirer l'armée du Tsar à franchir à son tour la Passarge pour ensuite l'écraser en détails. Bennigsen est un bon combattant, et ses défaites précédentes l'ont amené à être prudent. Il s'engage néanmoins et commence à subir les assauts destructeurs des corps de Soult et Bernadotte. Il décide alors de se replier sur Heilsberg, poursuivi par les cavaliers de Murat. De son côté, Lannes est au prise avec l'ennemi à Friedland. Napoléon envoie à son secours les carrés de Ney, Victor et Mortier, faisant même donner la Garde...
Le 14 juin au matin, l'offensive française est lancée. Bennigsen, ignorant totalement le regroupement français, envisage de prendre Napoléon à revers. Il se heurte dans sa manoeuvre au corps d'armée de Lannes qui, éprouvé par les combats de la veille, n'a plus que 10 000 hommes sous son commandement. Il donne alors l'illusion à Bennigsen que c'est le double de soldats qu'il rencontre en faisant donner son artillerie au maximum. Ce dernier tombe dans le piège, et tarde dans sa manoeuvre initiale, ce qui laisse le temps aux renforts français de se mettre en place. La cavalerie de Grouchy s'élance avec fougue, brisant les lignes de fantassins russes, tandis que les canons français jettent des pluies d'éclairs et de feu sur les pauvres cosaques. Pendant ce temps, Mortier boucle le secteur de Königsberg. Le plan est en place, les russes sont cernés de toute part...
A 17 heures, trois salves tirés par la Garde indique le refermement du piège, le début de la fin pour les russes de Bennigsen. Ney prend le village de Sortlack et fond sur les soldats de Gortchakov. Toute la Grande Armée se met en marche. Les russes, détruits, se battent avec un courage qui forcent l'admiration, mais en vain. Leur retraite est impossible, Mortier est là. Reste un passage par Friedland. Bennigsen investit la ville, et entreprend la contre-offensive. Un regain d'optimisme se fait sentir : les troupes regagnent du terrain ; hélas pour les russes, une contre-attaque française anéantit tout espoir. Les fuyards se jettent dans l'Alle pour rejoindre la réserve du Tsar, située sur l'autre rive...
A la tombée de la nuit, la bataille s'achève. La victoire est totale pour Napoléon qui lave ainsi l'affront d'Eylau. Bennigsen a perdu près de 17 000 hommes. 7 ans jour pour jour après Marengo, le génie de l'Empereur est toujours là...
Cinquième coalition
(Europe Centrale 1809)
PLAN DE LA COALITION
Ses défaites successives avaient convaincu l’Autriche de son infériorité militaire : aussi, après Austerlitz, confie-t-elle à l’archiduc Charles le soin d’y remédier. Celui-ci organise une armée de 300 000 hommes avec une réserve de 200 000 hommes. Comptant sur l’irritation de l’Allemagne, sur l’insurrection du Tyrol, sur la neutralité de la Russie, les subsides de l’Angleterre et surtout sur les embarras que causait à Napoléon la guerre d’Espagne, l’Autriche se décide à une lutte nouvelle avec l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal pour alliés. Elle met sur pied quatre armées : pendant que l’archiduc Charles avec 200 000 hommes opérera dans la vallée du Danube, l’archiduc Jean, avec 60 000 hommes envahira l’Italie ; l’archiduc Ferdinand, avec 30 000 hommes se portera dans le Grand-Duché de Varsovie, et Jellachich, avec 20 000 hommes soulèvera le Tyrol.
L’occasion semblait d’autant plus favorable que les troupes françaises, peu nombreuses en Allemagne, étaient dispersées sur une ligne s’étendant de Ratisbonne - corps de Davout - à Augsbourg - corps de Masséna.
OPERATIONS EN BAVIERE
Dès le 10 avril 1809, l’archiduc Charles, espérant que cette dispersion de ses ennemis lui permettra de les détruire en détail, passe l’Inn avec 150 000 hommes, pendant que son lieutenant, Bellegarde, sortant de Bohème, s’avançait avec 50 000 hommes sur Ratisbonne, par la rive gauche du Danube.
L’archiduc franchit l’Isar à Landshüt (16 avril), repoussant une division bavaroise qui est obligée de se replier derrière l’Abens, vers Neustadt. Il a l’intention de laisser un rideau de troupes devant Masséna et de se rabattre sur Ratisbonne pour attaquer Davout de front, pendant que Bellegarde déboucherait de Bohème sur les derrières du maréchal. Mais la lenteur de sa marche fait échouer ce plan habilement conçu. Napoléon, averti à temps, arrive sur le théâtre de la lutte à Donauwerth avec des renforts et les contingents de la Confédération, juste à temps pour conjurer les revers qui le menaçaient.
OPERATIONS SUR DIVERS THEATRES
En Italie, l’armée de l’archiduc Jean, débouchant de la Carinthie, bat le prince Eugène à Pordenone et à Sacile (16 avril), et le rejette sur la Piavve et l’Adige. Mais le prince Eugène, ayant reçu des renforts, rejette à son tour les Autrichiens derrière la Piave (8 mai), les poursuit par le col de Tarvis et, leur infligeant une dernière défaite sur la Raab (14 juin), les oblige à passer sur la rive gauche du Danube fort loin de l’archiduc Charles.
En Pologne, Poniatowski est d’abord battu par l’archiduc Ferdinand et contraint de lui céder Varsovie (20 avril) ; mais il se jette en Galicie, insurge le pays et force l’archiduc à se replier sur Cracovie.
Dans le Tyrol, le soulèvement des paysans - Andreas Hofer - permet aux Autrichiens d’entrer à Insbrück ; mais le général Lefébvre, parti de Salzbourg, réprime l’insurrection et chasse Jallachich du Tyrol. Ce dernier cherche à rejoindre l’archiduc Jean, mais il se heurte à Saint-Michel - sur la Mürh - au prince Eugène qui l’écrase (25 mai).
OPERATIONS EN AUTRICHE
Après la campagne des cinq jours, Napoléon marche sur Vienne par la rive droite du Danube, refoulant devant lui les troupes de Louis et de Hiller. Il franchit l’Inn et après l’horrible combat d’Ebersberg (note 1) (3 mai), il entre pour la seconde fois à Vienne (13 mai). Mais cette fois les ponts avaient été détruits. Il faut traverser le Danube en présence de l’archiduc Charles qui occupe le Marchfeld. Napoléon désigne pour le passage le point d’Ebersdorf où le fleuve est divisé par plusieurs îles et en particulier par la grande île de Lobau, en deux bras principaux dont le plus considérable longe la rive droite (note 2). Dès le 19, un pont de bateaux est établi sur le grand bras, et Masséna occupe l’île de Lobau ; pour le passage du petit bras des ponts sont jetés à une boucle rentrante du fleuve, dont les extrémités sont gardées par les villages d’Aspern et d’Essling. Le 20 mai, Masséna, puis Lannes passent sur la rive gauche et occupent solidement les deux villages. Le 21, l’archiduc se porte en masse, avec 90 000 hommes et 300 canons, contre les 25 000 Français qui vont se trouver isolés de tout secours par la rupture des ponts du petit bras. Une lutte sanglante s’engage, mais les Autrichiens ne parviennent pas à nous jeter au Danube. Pendant la nuit, les ponts étant rétablis, des renforts peuvent arriver, et, le lendemain (22), l’Empereur fait attaquer les Autrichiens avec 50 000 hommes : le centre ennemi va être enfoncé quand le pont du grand bras est emporté par une crue violente et les corps flottants lancés par l’ennemi. Napoléon ordonne alors la retraite dans l’île de Lobau ; à force d’héroïsme (note 3) , on se maintient dans Aspern et Essling jusqu’à la nuit pour couvrir le mouvement ; mais on fait des pertes énormes - 15 000 hommes - et Lannes a les deux genoux fracassés par un boulet : c’est Masséna qui dirige avec sa fermeté habituelle cette dangereuse opération.
Après sa défaite, l’archiduc Charles se retire sur la Thaya suivi par Masséna et Marmont. A Znaïm, il demande un armistice qui le 14 octobre est transformé en paix définitive par le traité de Vienne. L’Autriche perd Salzbourg et Braunau, les provinces Illyriennes, la Galicie.
1 - Voir les Mémoires du Comte de Ségur.
2 - Entre la rive droite et l’île de Lobau, il y a 700 mètres et entre Lobau et la rive gauche 120 mètres.
3 - Voir les Cahiers du Capitaine Coignet, et les Mémoires de Marbot.
Campagne des cinq jours
(19 au 23 avril 1809)
En arrivant à Donauwerth - 17 avril - Napoléon trouve ses troupes dispersées imprudemment d’Augsbourg - Masséna - à Ratisbonne - Davout - et mal reliées par le centre - Bavarois - à Neustadt et Donauwerth ; il donne des ordres pour leur concentration. Au moment où ces ordres s’exécutent, l’archiduc Charles, dont les forces - 120 000 hommes - étaient concentrées à Landshüt, les divise en deux corps sous Hiller avec l’archiduc Louis, et lui-même. C’est au cours de ces deux mouvements contraires que les deux armées se heurtent dans la région boisée comprise entre l’Isar et le Danube et arrosée par l’Abens, la Kleine et la Grosse-Laber. Cinq victoires en cinq jours.
Pendant que Masséna se porte sans difficulté d’Augsbourg sur Pfaffenhofen, Davout évacue Ratisbonne, en n’y laissant qu’un régiment. Mais en s’avançant sur les plateaux vers Abensberg, Davout se heurte contre l’archiduc Charles qui marchait sur Ratisbonne ; il culbute sa gauche à Tengen - 19 avril - et opère près d’Abensberg sa jonction avec l’Empereur qui en trois jours avait concentré 120.000 hommes. L’Empereur résolut alors de séparer définitivement les Autrichiens partagés en deux masses, l’une vers Tengen, l’autre sur l’Abens. Le 20, laissant Davout à Tengen, pour contenir l’archiduc Charles, il attaque Louis et Hiller de front à Abensberg, pendant que Masséna, dirigé de Pfaffenhofen sur Landshüt, doit leur couper la retraite ; Les Autrichiens sont battus et rejetés sur la Kleine-Laber, dans la direction de Landshüt. Le 21, les troupes de Napoléon et celles de Masséna convergent sur cette ville, l’enlèvent de vive force et rejettent Luis et Hiller au-delà de l’Isar, les séparant ainsi de l’archiduc Charles qui, pendant ces deux jours - 20 et 21 avril - était resté immobile sur la Grosse-Laber entre Tengen et Eckmühl.
Le 22, ce dernier, qui le 20 avait fait enlever Ratisbonne pour s’assurer le passage du Danube, se doutant qu’il était débordé vers le sud, se décide à livrer bataille à Eckmühl et à tenter, par sa droite, un mouvement sur Abach afin de menacer les communications des Français. Mais il se heurte à Davout qui, renouvelant l’exploit d’Auerstadt, résiste seul jusqu’au moment où l’arrivée de Napoléon avec Lannes et Masséna, débouchant de Landshüt, décide la retraite des Autrichiens sur Ratisbonne. L’archiduc, laissant quelques troupes dans cette ville, traverse promptement le Danube pour rejoindre l’armée de Bohème - Bellegarde - et descendre ensuite sur Vienne par la rive gauche du fleuve. Le 23, l’Empereur, après un vif combat - où il reçoit une légère blessure au talon - s’empare de Ratisbonne. Cette merveilleuse campagne de cinq jours coûte à l’archiduc 50.000 hommes et sa ligne d’opérations. Elle laisse Vienne à découvert.
La bataille d’Essling
Pendant la bataille, les français sont pris à revers par les autrichiens.
Les soldats décident d'eux-mêmes de regagner l'île de Lobau.
Après la grande campagne de 1806-1807 en Prusse et en Russie, la France était à son apogée. Mais la "sale affaire d'Espagne" a entraîné Napoléon dans une situation inextricable, l'obligeant à intervenir personnellement. L'Autriche a pensé que c'était pour elle le moment de se relever et de reprendre sa place prédominante en Europe. Elle leva une armée de 300 000 hommes, plus une réserve de 200 000 soldats (à force de défaites, les autrichiens sont devenus prévoyants...). C'est enfin l'Angleterre qui finance le tout, beaucoup trop même, vu l'état de ses finances (le blocus continental, mis en place en 1806, leur interdisant l'accès au commerce européen, l'a énormément ruinée). Napoléon réunit le plus de monde possible. Il dispose de 250 000 hommes utilisables immédiatement, un corps de réserve de 60 000 hommes commandés par Junot, la Garde bien sûr dirigée par Bessières, et enfin les polonais de Poniatowski, prêts à donné leur vie pour leur nouveau chef, au nombre de 16 000. Le 17 avril, les armées françaises se mettent en marche. Elles vont remporter cinq victoires en quatre jours : Tengen le 19, Abensberg le 20, Landshut le 21, Eckmühl et Ratisbonne le 23. Napoléon s'installe ensuite à Vienne désertée par la famille impériale autrichienne. Tous les ponts ont été détruits par l'archiduc Charles, le propre frère de l'Empereur, et Napoléon donne l'ordre d'en construire de nouveaux. Il s'installe sur l'île de Lobau avec ses hommes, et prépare son attaque...
Le 21 mai, très tôt le matin, 45 000 français traversent le fleuve et fondent sur les avants-gardes ennemis. Mais l'Autriche met en place sa contre offensive. Cinq régiments, rangés en colonne, partent à l'assaut. Bientôt les armées françaises sont acculées à la défensive. Une des divisions de Masséna est retranché dans la ville d'Essling. Le maréchal Lannes s'est porté en renfort. Le soir, les deux armées organisent une pause. Le lendemain, Napoléon a obtenu des renforts supplémentaires. Il attaque alors le premier, avec le corps de Davout. Lannes sera le pilier : l'issue de la bataille résultera de son efficacité. Les autrichiens réussissent à scinder l'armée française, suivant la technique chère aux Alliés. A 11 heures, Napoléon se trouve dans une mauvaise passe. Celui-ci galvanise ses troupes : il sait maintenant que l'archiduc va tenter de les refouler vers le fleuve, ce qui, si il y parvient, sera une hécatombe pour les français. Il envoie tous ses généraux à l'attaque. Et soudain un des plus terribles malheurs de sa vie le frappe : le maréchal Lannes, son meilleur officier, son meilleur ami, est gravement blessé aux jambes. Il refuse d'abord de le croire. Puis il le perçoit, étendu, agonisant. Il ne peut contenir ses larmes. Corvisart, le médecin personnel de sa Majesté, est formel : le grand maréchal Lannes, duc de Montebello, va mourir, ce n'est qu'une question d'heures. Napoléon décide de le veiller jusqu'au bout. Devant l'impassibilité guerrière de leur chef, certes compréhensible, mais très dangereuse, les officiers de la Grande Armée hésitent entre repasser le fleuve pour éviter le désastre tant redouté, ou bien continuer à lutter. Ils choisissent la seconde option, d'autant que Davout vient d'arriver avec ces troupes. Oui mais voila, le pont s'écroule, coupant ainsi l'arrivée des renforts. Napoléon remis sur pied tant bien que mal n'a plus le choix, il doit résister jusqu'au rétablissement du pont, où le Génie dirigée par l'infatigable Bertrand se tut à la tâche constamment. De son côté, Davout envoie par petits bateaux des munitions et des vivres. L'affrontement continue, plus terrible que jamais. Napoléon, fatigué physiquement et moralement comme la plupart de ses troupes, décide d'ordonner le replis car le pont vient tout juste d'être réparé. On ramasse les blessés dans la nuit du 22 au 23, et l'armée française repart en direction de Vienne.
Essling est une bataille mitigée, avec des pertes pratiquement identiques dans chaque camps. La mort du maréchal Lannes provoque deux sentiments chez les autrichiens : d'un côté, tout en saluant par les honneurs un ennemi loyal, ils exultent à l'idée que Napoléon est privé d'un très bon "lieutenant". Mais ils aussi terriblement inquiets de la réaction de l'Empereur, impitoyable d'ailleurs, qui surviendra à Wagram...
La bataille de wagram
Napoléon 1er regarde le champs de bataille de la colline de Wagram.
Il comprend sans émotion qu'il vient de remporter une immense victoire.
Après la bataille d'Essling, l'armée autrichienne était en partie détruite. Mais les derniers carrés s'étaient enfuis vers Wagram et Napoléon, à présent logé dans le palais impérial de Schönbrunn, avait décidé d'en finir. Pour obtenir la capitulation des autrichiens, il faut impérativement détruire leurs deux grandes armées. Les espions ont révélé à l'Empereur que l'archiduc Charles va jouer le tout pour le tout : il va tenter de contourner l'armée française, mais le flanc précis est inconnu. Napoléon a installé toute son armée sur l'île de Lobau, pour traverser le Danube. 100 000 hommes ont déjà franchi le fleuve le 5 juillet 1809. Les maréchaux de l'Empereur établissent des positions défensives, de façon à pouvoir intervenir rapidement et efficacement ; c'est ainsi que Masséna construit des tranchées, Oudinot sécurise les bourgs alentours de la ville de Rassdorf, Davout place son quartier général à Markgraf-Neusiedel, faisant face à Rosenberg, le talentueux mais infortuné autrichien. Quand au Prince Eugène, il brave les conseils de prudence de Napoléon et se présente seul face aux généraux Bellegarde et Hohenzollern. Tout est donc en place, la bataille ne va pas tardé à s'engager...
A 8 heures, l'assaut français est lancé avec une puissance extraordinaire. L'Empereur a remarqué une faiblesse dans une ligne de défense ennemie, et il souhaite exploiter cette brèche. Le maréchal Oudinot attaque à Russbach détenue par Hohenzollern, qu'il prend sans aucun problème. Mais la contre-attaque autrichienne se met en marche, et Davout se trouve en difficulté. Bernadotte, arrivé dans la nuit, s'élance sur le plateau de Wagram, après avoir conquis les abords de la ville d'Aderklaa, plus au sud. La nuit tombante, le combat ne baisse pas en intensité, et les autrichiens se défendent comme des lions (ils veulent tenir leurs positions jusqu'au bout). Grâce à ce courage désespéré, Napoléon a échoué dans sa tentative d'encerclement de l'armée de l'Archiduc. Néanmoins, les pertes ennemis sont terrifiantes (environ 10 000 morts et disparus). Le lendemain, à exactement 2 heures du matin, les deux camps reprennent leur offensive respective. L'Archiduc concentre ses forces à Aspern, en tentant de faire tomber le village détenu par Masséna et Bernadotte. Les français, sous la fantastique pression autrichienne (attaque coordonné de plus de 75 000 soldats), les deux chefs français sont obligés de se replier sur Wagram. A ce moment précis, la situation commence à devenir critique, et Napoléon aurait pu perdre la bataille, sans le fameux "coup d'oeil" qui l'a sauvé dans maintes occasions. A 14 heures, l'Empereur rassemble ses forces sur Aspern pour, à première vue, reconquérir la ville. Mais les projets de Napoléon en sont tout autres : il veut contourner des deux côtés l'armée autrichienne, et enfin seulement, après anéantissement de celle-ci, fondre sur les derniers carrés encore debout de la ville. Pour cela, il ordonne à Drout d'exécuter la manoeuvre. Cet ancien général, habitué de longues dates des techniques de guerre de l'Empereur, surnommé le "Sage de la Grande Armée", va mettre en place la plus formidable batterie d'artillerie dans une bataille : pas moins de 100 pièces de canons sont rassemblés en un même point, anéantissant les charges autrichiennes. Se lance ensuite les traditionnelles et puissantes charges françaises, menées par le célèbre général de Lasalle, qui malheureusement décèdera des suites de ses blessures. L'armée autrichienne de l'archiduc Charles est presque totalement anéantie, les maigres bataillons survivants de la tuerie s'enfuient déjà vers Vienne. Celui-ci laisse plus de 40 000 morts sur le plateau de Wagram, contre 20 000 pour les français.
Cette fantastique victoire, malgré tout durement acquise, se soldera par la capitulation de l'Empereur d'Autriche Français II (le propre neveu de Marie-Antoinette), celui-ci donnera sa fille à marier à Napoléon, laquelle deviendra la nouvelle Impératrice de l'Empire après Joséphine...
Le 10ème Régiment d'Infanterie Légère par la suite
Constitué en 1776 sous le nom de régiment de Neustrie avec les 1er et 3ème bataillons du régiment de Normandie. Il se conduisit avec une grande bravoure à Lutzen le 02 mai 1813 .Il tint tête à toutes les attaques de l'armée Prussienne et les repoussa victorieusement .Sur son étendard était inscrit : Fleurus 1794 - Lutzen 1813 - Toulouse 1814 - Sébastopol 1854-1855 .
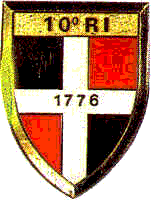
Les grands chefs qui ont eu sous leur commandment le 10ème léger
à Iéna et Eylau
IVème Corps d’Armée : Maréchal Soult
1ère division : Général St Hilaire
1ère brigade : Général Savetier de Candras
10ème léger : Colonel Pouzet
Situation à Amberg le 2 octobre 1806 du IVème corps :
26 bataillons, 12 escadrons, 28960 hommes dont 1876 cavaliers, 1782 artilleurs, 52 canons, 260 voitures.
Jean de Dieu Soult
duc de Dalmatie, Maréchal (1804).
(Saint-Amans-La Bastide (Tarn), 1769 - id, 1851)
Par Rudder
Musée National du chateau de Versailles et des Trianons
Soult, en sa qualité d’aîné, est destiné à reprendre l’étude de son père, notaire. Il préfère s’engager à quatorze ans dans l’Armée royale. Sa première paie permet d’épargner à sa famille la saisie des meubles. Après deux ans de service, il abandonne les armes, tente de se faire boulanger, mais se ré-engage rapidement.
En 1789, il adopte les idées révolutionnaires et gravit les échelons militaires. En 1794, à 25 ans, il est remarqué lors de la bataille de Fleurus et nommé général de brigade. Deux ans plus tard, il s’illustre à la bataille d’Altenkirchen (4 juin 1796).
En septembre 1799, devenu général de division à l’armée d’Helvétie, il prend part à la victoire de Zurich sous les ordres de Masséna. Il suit ce dernier à l’Armée d’Italie et prend part à la défense de Gênes, tandis que Bonaparte franchit le col du Grand-Saint Bernard.
A la fin de l’année 1800, il est chargé par le Premier Consul de pacifier le Piémont. En 1802, Soult est devenu colonel général de l’infanterie légère de la Garde consulaire et ardent bonapartiste. L’avènement de l’Empire (1804) lui apporte titres et gloire. Il est nommé maréchal le 19 mai et grand officier de la Légion d’Honneur.
Commandant du camp de Saint-Omer, à Boulogne, il forme le IVème corps de la Grande Armée, imposant une discipline sévère à ses hommes. C’est le début d’une réputation de chef impitoyable qui lui vaut le surnom de "Bras de fer" par ses soldats.
Son corps d’armée joue un rôle essentiel lors de la bataille d’Austerlitz (2 décembre 1805), en s’emparant du plateau du Pratzen. Napoléon lui en fait compliment, le qualifiant de "premier manœuvrier d’Europe". Soult participe ensuite à la campagne de Prusse et de Pologne, et s’illustre notamment à Iéna (14 octobre 1806) et à Eylau (8 février 1807). Le 16 juin 1807, il prend la ville de Kœnigsberg.
En 1808, il accompagne Napoléon en Espagne. Fait duc de Dalmatie, il commande le IIème corps de la Grande Armée. D’abord victorieux, il s’avance jusqu’au Portugal. Il y impose l’ordre et laisse parler de lui comme du futur Roi du Portugal. Wellington brise ses espoirs en le battant à Oporto. Le maréchal français prend sa revanche à Ocaña, le 19 novembre
1809.
Major général de Joseph, restauré sur le trône espagnol, il parvient à soumettre l’Andalousie en 1810 et devient le gouverneur de cette province. En 1812, il est forcé à la retraite par les victoires de Wellington.
En 1813, après un bref passage en Allemagne, Soult est à nouveau renvoyé en Espagne pour contrer Wellington. Il ne peut arrêter le général anglais, dont les forces sont quatre fois supérieures aux siennes, et doit repasser les Pyrénées. Battu à Orthez le 27 février 1814, il résiste avec acharnement, freinant l’avance de Wellington par tous les moyens. A Toulouse, en avril, il soutient le siège à 25 000 hommes contre 100 000 jusqu’à la nouvelle de l’abdication de l’Empereur.
Sous Louis XVIII, Soult devient ministre de la Guerre. Napoléon, de retour de l’île d’Elbe, lui pardonne ses proclamations anti-bonapartistes, Soult l’a qualifié d’"usurpateur" et d’"aventurier" pour le placer major général de son armée. S’il n’atteint pas l’efficacité de Berthier, il combat néanmoins bravement à Waterloo, du 15 au 18 juin 1815.
Après la défaite, il se retire dans son château de Soulberg, parmi une très belle collection de tableaux de maîtres espagnols, fruit de ses pillages. Ses protestations n’ont en effet pas infléchi le Roi. Il sera pardonné en 1819 et rétabli dans ses titres l’année suivante.
Pair de France sous Charles X, il joue son plus grand rôle politique sous Louis-Philippe. Il est d’abord ministre de la Guerre puis président du Conseil. En avril 1838, il est l’ambassadeur de la France pour le couronnement de la reine Victoria en Angleterre. C’est le prélude d’une carrière de ministre des Affaires Etrangères, interrompue en 1840 par le retour au pouvoir de son adversaire, Thiers qu'il appelait "Foutriquet". Le ministère de ce dernier ne devait durer que huit mois. Guizot succédant à Thiers, Soult est nommé président du Conseil. Poste qu'il occupe sans interruption de 1840 à 1847.
En 1847, le vieux maréchal se retire définitivement pour raison de santé, avec le glorieux titre de maréchal général et s'éteint le 19 novembre 1851, dans son village natal, aujourd'hui SAINT AMANS SOULT, soit quelques jours avant le coup d'état de LOUIS NAPOLEON.
à Essling
Jean Lannes (1769-1809) Duc de Montebello
Maréchal de France "Le Roland de l'Armée d'Italie" - "L'Achille de la Grande Armée"
Chef du 2ème Corps d’Armée.
Né à Lectoure (Gers), le 10 avril 1769. Fils d'un garçon d'écurie. Apprenti teinturier. Bataillon de volontaires du
Gers, en 1792. Nommé sous-lieutenant, sous les ordres du général de Laterrade. Écarté pour raison politique en 1795.
Général en 1795 Épouse Paulette Méric le 19 mars 1795. Il se rengage en 1796, dans l'armée d'Italie. Napoléon
le rétablit dans son grade. Bataille de Dego, le 15 avril 1796. Bataille de Lodi, le 10 mai 1796.Lannes commande les
6ème et 7ème bataillons de grenadiers, 4ème bataillon de carabiniers. Arcole, 14-15 novembre 1796, il est blessé de
deux balles. Bataille de Rivoli, 14 janvier 1797. Nommé général de brigade en 1797. Il devient ami avec Bonaparte.
Prise de la ville d'Imola. Bonaparte l'envoie pour régler le traité de Tolentino avec le Pape, il restaure l'ordre
dans les Etats. A Marseille en octobre 1797 pour combattre les royalistes. Campagne d'Egypte. Bataille des Pyramides.
Prise de Jaffa, le 3 mars 1799. Le 17 mars prise de Haïfa. Siège de Saint-Jean d'Acre, du 19 mars au 20/21 mai. Il
est sévèrement blessé. Promu général de division, le 10 mai 1799. Bataille d'Aboukir, 25 juillet 1799. Il rentre en
France avec Bonaparte. Participe au coup d'État du 18 Brumaire. Il commande la Garde consulaire. Il en est l'inspecteur
Général. Divorce le 25 juillet 1799 (pour cause d'infidélité de sa femme). Seconde campagne Italienne. Il commande
l'avant-garde. Bataille de Montebello, le 9 juin 1800. Marengo le 14 juin 1800. Il reçoit un sabre d'honneur des consuls.
Épouse Louise Antoinette Guéheeneuc le 15 septembre 1800 (5 fils). Ministre plénipotentiaire au Portugal en 1802.
Il est promu maréchal de France, le 9 mai 1804. Campagne d'Autriche. Il commande le 5e corps. Austerlitz le 2
décembre 1805. Il commande l'aile gauche. Campagne de Prusse, en 1806. Bataille de Saafeld, il défait le Prince
Ludwig de Prusse. Bataille de Iéna le 14 octobre 1806. Il commande le centre de la Grande Armée. Bataille de
Pultusk, le 26 décembre 1806, il est blessé. Bataille de Friedland, le 14 juin 1807. Nommé Colonel Général des
Suisses en 1807. En 1808, il est en Espagne. Il est nommé duc de Montebello le 15 juin 1808. Victoire de Tulda,
novembre 1808. Prise de Saragosse en février 1809. Il reste en Espagne jusqu'en 1809. Campagne d'Autriche.
Commande un Corps provisoire puis le IIe Corps. Bataille d'Eckmühl, le 22 avril 1809. Siège de Rastibonne.
Bataille d'Amstetten. Mortellement blessé à Essling, 12 mai 1809. Meurt neuf jours après, à Vienne, les deux
jambes amputés, le 31 mai 1809. Ses restes sont au Panthéon en 1810. Il fut sans doute le meilleur ami de Napoléon.
Son courage était légendaire.
Louis Vincent Saint-Hilaire (1766-1809)
Chef de Corps de la 3ème division d’Infanterie à Essling sous les ordres de Lannes
Né en 1766. Général à Austerlitz. Il est mortellement blessé en 1809, à Aspern-Essling Essling-Wagram.
à Wagram
Nicolas Charles Oudinot ,
Duc de Reggio, Maréchal (1809)
Bar-le-Duc (Meuse), 1767 - Paris, 1847.
Chef du 2ème Corps d’Armée.
Nicolas Charles Oudinot
Par Lefebvre
Musée National du Chateau de Versailles et des Trianons Le "Bayard de l’armée française". (Napoléon)
Ce fils de brasseur choisit de s’engager dans un régiment d’infanterie à 17 ans. Rappelé par son père qui le voudrait comme successeur, Oudinot revient au village et se marie. C’est la Révolution qui le rappelle dans les rangs de l’armée. Cet ancien soldat est vite élu lieutenant-colonel des volontaires de la Meuse.
En 1793, il s’illustre en repoussant une attaque prussienne du château de Bitche. L’année suivante, grâce à un nouveau fait d’armes, il est général de brigade. Il sert ensuite dans l’Armée de Rhin-et-Moselle. A la bataille de Neckerau, il est blessé, la première d’une longue série de blessures, et fait prisonnier, pour être échangé quelques mois plus tard. Oudinot sert ensuite sous Moreau et passe en 1799 dans l’armée d’Helvétie. Masséna, dont il est le chef d’état-major pour la prise de Zurich et de Constance, le nomme général de division.
Quand vient le Consulat, Oudinot poursuit sa carrière auprès de Masséna, lors du siège de Gênes. Il se distingue lors du passage du Mincio en décembre 1800.
En 1805, le voici à la tête de 10 000 grenadiers. Après une série de victoires et une participation importante à la bataille d’Austerlitz, son corps d’élite est surnommé les "grenadiers Oudinot". Le succès ne le quitte pas, notamment à Ostrolenka en février 1807, à Friedland en juin, ce qui lui vaut le titre de comte. En 1808, gouverneur d’Erfurt, il organise l’entrevue entre Napoléon et Alexandre 1er. L’Empereur le présente au tsar comme le "Bayard de l’armée française".
En 1809, Oudinot continue son glorieux parcours, avec un sommet à Wagram où il apporte la victoire par une intervention clairvoyante. Il reçoit le bâton de maréchal quelques jours plus tard, puis le titre ducal.
En 1810, il est chargé d’occuper la Hollande, que Louis Bonaparte vient d’abandonner. Il est ensuite gouverneur de Berlin avant d’entamer la campagne de Russie. Là encore, il se montre admirable, notamment lors du passage de la Bérézina. En 1813, il est de la bataille de Bautzen. Deux mois plus tard, il est battu par Bernadotte à Gross-Beeren. Il se rattrape à Wachau, où il bat le prince de Wurtenberg. C’est ensuite la campagne de France.
Le 4 avril 1814, Oudinot est de ceux qui demandent à l’Empereur d’abdiquer. Il se rallie alors à Louis XVIII, qui lui confie le commandement de l’ancienne Garde impériale. Oudinot est l’un des rares maréchaux à ne pas se rallier à Napoléon lors des Cent-Jours. En récompense, Louis XVIII le nomme commandant de la Garde royale puis de la Garde nationale de Paris. En 1823, Oudinot dirige le 1er corps de l’expédition d’Espagne. En 1830, d’abord retiré dans ses terres, il est nommé grand-chancelier de la Légion d’Honneur en 1839 et gouverneur des Invalides en 1842.
Des onze enfants d’Oudinot, quatre sont des garçons.Tous seront militaires.
Charles Louis Grandjean
Chef de Corps de la 3ème division d’Infanterie à Wagram sous les ordres d’Oudinot
Né le 29 décembre 1768 à Nancy. Elu commandant par la garde nationale de Chateau-Salins en 1789. S'engage en 1792 dans l'armée du Rhin, avec le grade de lieutenant. Passe à l'armée d'Italie, où il est fait général de brigade en 1799. En 1800, il est de retour sur l'armée du Rhin, se distinguant à Hohenlinden. Général de division en 1805, il est au camp de Boulogne puis à l'armée du Nord. Campagne de 1807, où il participe notamment au siège de Dantzig et de Stalsund. En Espagne en 1808, puis sur le Danube en 1809. Baron de l'Empire en 1810, il est fait prisonnier à la capitulation de Dantzig. De sa prison, il envoie son adhésion à Louis XVIII, ce qui lui vaut d'être fait comte par celui-ci, mais ne l'empêche pas de se rallier pendant les Cent-Jours. Député de la Meurthe de 1821 à 1823, il meurt à Nancy le 5 septembre 1828.
Blessé à Wagram, à la tête de la 3 e division du IIe corps d'armée (Oudinot).

|
