|
Un brin d’histoire
Village du Ségala Tarnais, berceau de la famille GIL.
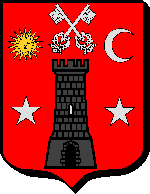 Le Ségala concerne l’extrême nord du département du Tarn. Situé dans la vallée du Cérou, "la ville de Monestiés" fut longtemps le siège administratif de la contrée; Baronnie rattachée après les croisades à l'Archevêché d'Albi et qui sera chef lieu de canton quelques temps après la Révolution, suite au nouveau découpage administratif napoléonien. Monestiés se trouve à quelques 14 kilomètres de Cordes et 7 kilomètres de Carmaux. Très belle cité médiévale nichée dans une courbe du Cérou, avec son église gothique de 1824 à base romane plus ancienne et son rétable de 1666. Témoins du passé glorieux de la cité: le château du Candèze, qui joua un rôle déterminant durant la croisade contre les Albigeois; le pont du Candèze, situé sur la voie romaine de Rodez à Toulouse. Monestiés est entouré au nord par Trévien, avec son église gothique du XVème siècle vouée à Saint Michel et son château du XVIème siècle. Au sud par Combéfa et son château en ruine du XIIIème siècle, résidence d’été des archevêques d’Albi du XIIIème au XVIème. Plus à l’ouest en remontant la vallée, Salles, village qui autrefois était fortifié, avec un énorme donjon encore existant, carré et sans ouverture, une église au portail du XIVème siècle et ses chapiteaux romans et statues du XVIème siècle " les quatre vertus ". Le Ségala concerne l’extrême nord du département du Tarn. Situé dans la vallée du Cérou, "la ville de Monestiés" fut longtemps le siège administratif de la contrée; Baronnie rattachée après les croisades à l'Archevêché d'Albi et qui sera chef lieu de canton quelques temps après la Révolution, suite au nouveau découpage administratif napoléonien. Monestiés se trouve à quelques 14 kilomètres de Cordes et 7 kilomètres de Carmaux. Très belle cité médiévale nichée dans une courbe du Cérou, avec son église gothique de 1824 à base romane plus ancienne et son rétable de 1666. Témoins du passé glorieux de la cité: le château du Candèze, qui joua un rôle déterminant durant la croisade contre les Albigeois; le pont du Candèze, situé sur la voie romaine de Rodez à Toulouse. Monestiés est entouré au nord par Trévien, avec son église gothique du XVème siècle vouée à Saint Michel et son château du XVIème siècle. Au sud par Combéfa et son château en ruine du XIIIème siècle, résidence d’été des archevêques d’Albi du XIIIème au XVIème. Plus à l’ouest en remontant la vallée, Salles, village qui autrefois était fortifié, avec un énorme donjon encore existant, carré et sans ouverture, une église au portail du XIVème siècle et ses chapiteaux romans et statues du XVIème siècle " les quatre vertus ".
Approche générale
Le Languedoc est une ancienne province du sud de la France, dont la partie centrale forme actuellement avec le Roussillon, la région Languedoc-Roussillon regroupant les cinq départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales.
Conquise par les Romains dès le IIème av. J.C., cette région se trouve sous la domination des Wisigoths au Vème siècle. Après les invasions barbares du VIIIème siècle, Charles Martel se rendit maître du Midi, en assiégeant Narbonne en 759 et en libérant par la suite Toulouse, l’Albigeois, et le Gévaudan. Charlemagne poursuivit la pacification du Languedoc en pourchassant à plusieurs reprises, les Sarrasins jusqu’en Espagne. Il érigea pour son fils Louis le Débonnaire, le royaume d’Aquitaine auquel il joignit Toulouse et la plus grande partie du haut Languedoc. Il établit dans les principales villes, des comtes, des ducs et marquis, qui étaient destituables ou instituables à volonté. C’est en 778 que le premier comte de Toulouse apparaît, un certain Chorson, révoqué en 790. C’est de lui que descendront les comtes de Toulouse. Fut établit un duc de Septimanie à Narbonne, pour avoir autorité sur le bas Languedoc; il y avait donc division du Languedoc à cette époque.
« Le Languedoc fut pendant quelques temps comme divisé entre les comtes de Toulouse et les ducs de Septimanie ou marquis de Gothie. Ces derniers commandèrent depuis l’an 829 successivement au nombre de huit jusqu’en l’année 936. Le premier fut Bernard Ier, fils du vicomte de Narbonne Saint-Guillaume de Gellone en 820, et le dernier Guillaume le Pieux, comte d’Auvergne, qui donne ses terres à Raimond, comte de Toulouse en 918 et devient duc de Septimanie qui fit hommage à Rodolphe, duc de Bourgogne puis Roi de France de 923 à 936.
Le Languedoc passe totalement sous l'autorité des comtes de Toulouse au XIIème siècle. Mais après la guerre des Albigeois (1209-1229), le Languedoc est rattaché à la Couronne en 1271. Ralliée à la cause du dauphin Charles en 1420, par le traité de Troyes, il fut doté d'un parlement résident à Toulouse en 1444, d'une cour des aides en 1478, et d'une chambre des comptes en 1523. Institutions qui disparurent à la Révolution. »
Mémoires sur la Province de Languedoc pour l’instruction du duc de Bourgogne par l’Intendant Nicolas de Basville XVIIème siècle. (tiré de l’édition critique de Françoise Moreil - Paris 1985)
Monestiés : Les grands évènements
L’Origine
« Mentionné pour la première fois en 961, Monestiés était sous la féodalité, une des douze
villes fortifiées du diocèse d'Albi.
En sortant de Monestiés par le faubourg du bary en direction du Trévien, St. Pierre de Gil et
Almayrac, on aperçoit le Castel Raynal les Monestiés, ayant appartenu au marquis de Castelpers, seigneur de Trévien
et baron de Puységur. Ce château était le siège de la juridiction. L'hôpital St. Jacques de peu d'importance jusque
là, se haussa alors au niveau de monument historique, en devenant le refuge des célèbres statues de Combéfa, après
la démolition de la forteresse ecclésiastique. La Bastidette, au confluent du Cérou et du Céret était un fief;
également chef lieu féodal mentionné en 1229 sur les registres notariaux.
L'étymologie de Monestiés vient de Monaster, due à l'existence d'un monastère dont il est fait
mention dans le testament de Raymond Ier , marquis de Gothie, comte du Rouergue. Il est fait une première fois
mention du monastère de Monestiés dans ce testament, légué par Raymond à son épouse Berthe en 969 à la condition
qu’il serait compris dans l’apanage de Raymond leur fils. Le Monastère fut fortifié car l'endroit était un des
points les plus stratégiques de la région. La baronnie de Monestiés prend son point de départ en 1229, date de
la fondation du prieuré du Ségur. A cette date, les seigneurs des fiefs rendirent hommage à l’évêque d’Albi
devenu seigneur de la vallée de Monestiés grâce aux incours : confiscations opérées sur les seigneurs
hérétiques albigeois. En 1283 Philippe IV le Bel confirma les évêques dans cette possession. En 1359 le roi
Jean mit au pouvoir de l’évêque d'Albi, la tour de Monestiés. D'après les chroniques du Languedoc il était
haut justicier de Monestiés et maître du château lorsque celui-ci fut confisqué au comte Raymond. Tout ceci
s'appelait la baronnie de Monestiés, dont l'autorité s'étendait aux lieux de Carmaux, St.Benoit, La Bastide
Gabausse, Le Trévien, Almayrac et le Suech. La Seigneurie était très importante. Elle donna son nom à une
famille (1) considérable dont on retrouve
les descendants jusqu’au milieu du XVIIème siècle mais après la croisade contre les albigeois,
elle passa aux évêques d'Albi qui l'ont gardée jusqu'à la révolution et qui y perçurent les droits seigneuriaux et
en nommèrent les consuls.
Mais la suzeraineté d’Albi sur Monestiés était-elle antérieure à la croisade contre les Albigeois,
ou bien ne fut-elle établie qu’à cette époque et acceptée pieusement cimme une protestation efficace dans des
conjonctures critiques. Ce qui est certain, c’est qu’au-dessus de la haute seigneurie épiscopale s’élevait
encore sur les mêmes lieux la domination des comtes de Toulouse. Au XIIIème siècle et même avant,
ces princes possédaient dans le Nord de l’Albigeois, soit des domaines, soit des redevances ou des hommages
de chevaliers. Ils furent momentanément dépossédés de ces biens par les croisés, mais après le guerre ils
recouvrèrent tous leurs droits et entre autres certains services qui établissaient leurs pouvoirs supérieurs
sur la région. On apprend par les textes, et par déposition des deux principaux chevaliers de Monestiés, Adhémar
de Salles et Ramond de Narthoux, que Raimond V et après lui, son fils, et son petit-fils, possédèrent et perçurent
l’albergue dans le château ainsi que dans les divers territoires qui en dépendaient. Ces droits d’albergue dont on
trouve mention dans l’acte du 4 mars 1229 est la plus ancienne. Ces droits seront transmis aux rois de France,
leurs héritiers. Ils sont cités notamment vers 1272 et 1273 et reparaissent dans divers actes du 17ème
siècle. »
D'après l’œuvre du Docteur Louis Calmels "Monestiès Combefa" 1932 Rodez
1 Monestiés : Les porteurs actuels du patronyme Monestiés descendraient d'un bâtard de Gabriel
de Monestiés, seigneur de Trévien, né vers 1508 et qui n'eut de ses trois mariages que deux filles légitimes mais qui
par ailleurs eut plusieurs enfants naturels dont des garçons qui s'appelèrent Monestiés. Porté dans la région de
Montirat (Tarn) et de Saint-André (Aveyron). Ce nom est celui d’une famille héroïne "d'al brès a la toumbo",
recueil de poèmes de l’abbé Bessou.
A cet effet nous avons retrouvé deux documents aux AD-81, en sous-série 3 E qui n'ont pas
d'incidence directe avec la généalogie de la famille Gil, mais sont toutefois intéressant du point de vue historique
et économique, et plus particulièrement sur les us et coutumes du haut pays Tarnais sous l'Ancien Régime.
Le premier est daté du 20 septembre 1609; il s'agit d'un contrat d'albergement dressé par
les Commissaires royaux, par lequel le Roi Henri IV et la Reine Margueritte de Valois, Duchesse de Chalons et
Contesse de nombreux lieux. Cette dernière cède ses terres, fiefs nobles et roturiers qui se trouvent sous la
dépendance de la Jugerie (ressort d'une juridiction) d'Albi, à savoir: La seigneurie de Monestiés dont la Directe,
ainsi que leurs dépendances de Saint-Benoît, Le Suech, Cayleuses, La Bastide Gabausse et Almayrac, au "Sieur
Evêque d'Alby", seigneur temporel d'Albi et Baron de Monestiés. Ceci sous la condition d'une redevance annuelle
l'albergue (2) , de 36 Livres 13 Sols et 4 deniers payable à la Saint-Vincent, somme devant être réunie par le premier
consul de la ville de Monestiés chaque année, pour l'ensemble des habitants des lieux cités ci-dessus; et remise au
juge commissaire de la jugerie d'Albi. En vertu de cet ordre les consuls furent assignés devant Jean de Gineste,
juge mage et lieutenant général de la sénéchaussée de Toulouse, qui, après avoir entendu leurs déclarations,
ordonna qu’ils seraient maintenus dans leurs franchises et privilèges moyennat le paiement du droit d’albergue
annuellement exigé.
Sources : Etudes historiques et documents inédits sur l’Albigeois de Cl. Compayré 1841 Albi.
2 Albergue : Obligation de la part du vassal de loger et de défrayer le seigneur avec un certain
nombre de gens de sa suite.

Pour accéder à la taille réelle du document cliquer sur la loupe :

Le second document est un extrait des registres de la Cour des Comptes, Aides et Finances de
Montpellier daté du 28 novembre 1698. Ce document, dressé par les Commissaires de la Cour des Comptes de Montpellier,
reprend sur le fond le problème du paiement de l'albergue, déjà maintes fois soulevé par différents documents actes,
lettres patentes, à différentes périodes. Nous notons au passage que l'albergue reste inchangée quant à la somme exigée
depuis 1282, soit 36 Livres 13 sols et 4 deniers.
"Entre Messire Charles Legoux de la Berchère, Archevêque et Seigneur temporel de la ville d'Albi, Baron de Monestiés, Lagarde, Viaur, Montirat et Milhaut et leurs dépendances, demandant par requête du 19 juillet dernier en condamnant de la redevance de 3 setiers d'avoine et autres droits aujourd'hui pour les habitants possesseurs du fief de Lisarnié, dépendant de sa seigneurie de Montirat de l'alberge de 36 Livres 13 sols et 4 deniers; également pour les consuls et comité de Monestiés et invadés en dépendant, l'ensemble de l'alberge de 4 setiers de blé et 4 d'avoine pour le droit de
bladade (3), deux pour la comtesse du lieu de Milhaut avec les arrérages depuis 29 ans. Ce faisant, il déclare tous les droits lui appartenir à lui et à son église, et que les emphytéotes consuls et habitants des lieux passeront une nouvelle reconnaissance des droits à son profit chacun les concernant, d'autres veulent la requête du Seigneur archevêque, en condamnant les droits aux ordres de la cour sur les parties assignées du 19 juillet dernier, assignant aux fermiers et consuls à une requête du fermier général du domaine de la généralité datée du 24 novembre de la présente année par laquelle prenant le fait et cause de tous fermiers, et insistant aux fins de non recevoir une autre requête avec l'ordre de la cour de réglementer à produire au cours du mois de février 1282 contenant une transaction entre Philippe III Roi de France et l'Evêque d'Alby de ce temps là par lequel le Roi requêtant que son droit sur les seigneuries, sur les terres de Lagerde, Montirat, Monestiés et leurs dépendances était incertain et que les anciens comptes datés avaient cédés aux évêques d'Alby les châteaux et seigneuries de Monestiés, Montirat et Lagarde et toutes leurs dépendances en alberges. La seigneurie de Virac avec toutes les dépendances et tous autres droits en dépendant, ce qui avait été réglé par l'arbitrage de l'évêque de Rodez. Recevant seulement la simple requête verbale pour les terres qu'ils fait travailler. Sa majesté royale dans son droit incertain, préfère mieux céder son droit que d'ennuyer autrui, voulant traiter favorablement.
L'église d'Alby et son évêque, transmet céde et donne à son église d'Alby tous les droits que sa majesté peut avoir dans les lieux de Montirat, Monestiés, Lagerde et leurs dépendances à perpétuité pour que le travail se fasse avec plus de zèle, voulant qu'il ne lui soit fait aucun trouble ni empiètement, même tous les droits de confiscation qui auraient put être admis par le passé, ainsi qu'à l'avenir voulant qu'en cas, les fermiers et officiers de sa majasté tiennent quelque chose de l'evêque qu'il lui soit vendu dans l'an qui vient, voulant que tout ce qui pourrait être fait soit nul et non avenu. L'évêque serait servant dans l'acte, le droit du fief, le leur, la seigneurie de Castelnau de Bonnefoux. Requête verbale faite par Raymond comte de Toulouse à l'évêque d'Alby; de la terre de Castelnau de Bonnefoux, qu'il fait à chaque mutation. L'évêque ne pouvant exiger aucun droit et l'évêque a accoutumé de lui faire pareille reconnaissance qu'en l'an 1241.
Autre requête verbale d'Alphonse de France, comte de Toulouse, auprès de l'évêque de la terre de Castelnau et déclare que l'évêque lui fait pareille requête pour Montirat. Sans qu'il puisse rien exiger de plus de lui; l'un et l'autre de l'an 1270.
Lettres patentes de Philippe de Valois, Roi de France qui confirme l'évêque d'Alby dans le droit de recevoir le serment de fidélité et confirme la transaction du 24 février 1328.
Autres lettres patentes de Charles VIII qui confirme la dite transaction de 1282 de l'an 1484; autres lettres patentes confirmant la dite transaction, données par Louis XI en 1463; autres lettres du Roi Louis XIII portant confirmation de la transaction de 1282 en 1618. Certificat du fermier du domaine de la ville de Cordes par lesquels, il paraît que les droits ont été payés et exigés par les emphitéotes et habitants longtemps après que soit tiré l'extrait des comptes, au profit du Roi, l'alberge de 36 Livres 13 sols et 4 deniers par les consuls et habitants de Monestiés et lieux en dépendant de l'année 1461. Autres requêtes faites au profit du Roi par les consuls et habitants de Milhaut de l'alberge de 4 setiers d'avoine pour le droit de bladade de l'année 1461. Autres requêtes faites au profit du Roi par une partie des habitants du fief de Lisarnié pour la redevance de 3 setiers d'avoine comme une dépense de Montirat et Lagarde, autre requête faite au profit du Roi de l'alberge de 36 Livres 13 sols et 4 deniers par les consuls et comité de Monestiés par laquelle ils déclarent que l'évêque est leur seigneur en tout et qu'il faut donner l'alberge au Roi sans savoir d'où elle provient. En l'année 1618, autre reconnaissance faite au profit du Roi pour le droit de bladade où il est énoncé plusieurs autres requête pour 4 setiers de blé et 4 d'avoine d'alberge de l'an 1642, ordre du nommé grand compteur député par les Trésoriers de France, qui condamnent les habitants du Massage de Lisarnié et autres endroits de pesade. En l'année 1534 conclusions du Procureur général du Roi qui insiste aux fins de non recevoir. Il a été dit que la cour sans avoir égard aux fins de non recevoir du Procureur du Roi ni à la requête du fermier du domaine, au 24 du mois prochain, ayant aucunement eu égard à la règle du Sieur de la Berchère, Archevêque d'Albi a déclaré le fief de Lisarnié ensemble les alberges et autres droits seigneuriaux dont il est question à appartenir aux archevêques d'Albi et à leur église et déclare du mois de février 1282 à fait et fait défenses aux fermiers du domaine et à tous autres qu'il appartiendra de lui donner pour raison d'aucun trouble ni empêchement à peine de 400 Livres d'amende (2000 Frs environ en or de 1914) et autres arbitraires et en conséquence a ordonné et ordonne que dans le mois, les consuls et habitants des lieux de Monestiés, Milhaut et leurs dépendances, ensemble les possesseurs du fief de Lisarnié passeront nouvelle reconnaissance des droits au profit du Roi et du Sieur Archevêque et de son église et lui paieront à l'avenir, les alberges et redevances énoncés dans les règles du 12 décembre 1461. Le 13 mars 1463, les consuls et habitants de Monestiés et invadés ou dépendants l'alberge de 36 Livres 13 sols et 4 deniers payable à la fête de la Saint-Vincent et ceux de Milhaut de l'alberge de 4 setiers de froment et 4 setiers d'avoine, mesure de la ville de Cordes au jour et fête de Saint-Luc et ceux de Lisarnié en la "invidiction" de Montirat et Lagarde de la redevance de 3 setiers d'avoine mesure du dit Montirat payable à la fête de Noël autrement, ils y seront contraint chacun en ce qui le concerne par toutes voies de droit. Et à peine de consolidation de tutelle au lieu de La Directe et sur le surplus de la requête du Sieur Archevêque condamnant des arrérages de l'alberge depuis 29 ans autres demandes fins et conclusions des parties omises hors de tout et de procès tous dépenses et compenses faites et donnés à Montpellier en la Cour des Aydes, Comptes et Finances le 28 novembre 1698. Signature illisible.
Coll. signifié à Messires Nesnioles, Romiac et Coste........passant à leurs clercs et bailles copie. Les mandants........................Messire De Ratte rapporteur.
L'an 1698 et le 18 décembre à la requête de Messire Charles Legoux de la Berchère, Archevêque d'Albi, le présent arrêt a été intimé et signifié au premier Consul de Monestiés par petit, ce faisant ils ont été requis de payer l'alberge mentionnée ici et de passer nouvelle reconnaissance en faveur du dit Seigneur archevêque conformément au dit arrêt par devant Alexis Mercadier consul du dit Monestiés nommé en personne à son domicile.
Petit Baille, signé".
(transcrit de l'original, le style de l'époque et certaines orthographes ayant été conservés)



« Guillaume Cérisay reçoit du Roi le 5 octobre 1469, les terres de la seigneurie de Monestier. Il était greffier au Parlement de Paris. La seigneurie était avant cet événement, propriété du Comte d’Armagnac, qui en fut dessaisit sur ordre du Roi. »
Histoire du Languedoc - Dom Dévic & Dom Vaissette - tome 11.
La grande pandémie
Causes et conséquences de la peste.
« La période qui va de 1348 à 1460 environ marque une rupture complète avec les siècles d'essor qui l'ont précédée. Effondrement démographique, marasme économique. Tout indique une époque de crise, la plus grave qu'ait traversée les régions du Midi de la France depuis le haut moyen-âge jusqu'à nos jours.
Dès la première moitié du XIVème siècle, avant même le déclenchement de la catastrophe,
on note certains pogromes inquiétants. Famines et disettes frappent tantôt le haut, tantôt le bas Languedoc à une cadence
alarmante. On en signale en 1302-1303-1304-1305-1310-12-13-22-23-29-35-37-39-41-45-46 et 1347. Il est évident que la
population du pays à force d'augmenter depuis des siècles, est devenue trop nombreuse, relativement aux subsistances
disponibles et aussi au marché du travail. Des bandes de vagabonds et de misérables, les
pastoureaux (4), errent dans les campagnes.
Venue d'Asie au printemps de 1348, elle est à pied d'œuvre en Languedoc. Quelques documents
disent l'ampleur du fléau. A Albi, les cadastres ou compoix de 1343 et 1347 permettent une statistique précise.
La population de la ville tombe de 10000 à 5000 habitants. Le fléau devient récurrent. Il se manifeste encore avec
violence, notamment en 1361 et 1375; pratiquement il subsiste à l'état endémique dans la région jusqu'au début du
XVIème siècle.
Le désastre de 1348 et ceux qui le suivent modifient complètement les bases de l'activité
économique. Les campagnes, jusque là surpeuplées, se vident. L'exploitation se concentre sur les bonnes terres,
tandis qu'on abandonne les garrigues, les pentes montagneuses et les zones palustres, bref les terres marginales.
La population des trois sénéchaussées d'après l'état des feux de 1328 peut-être estimée très grossièrement à 1 500 000
habitants contre 1 600 000 en 1789 et 2 500 000 en 1960.
La guerre franco-anglaise aggrave encore cette situation. En 1355, l'armée anglo-saxonne et
gasconne du prince noir ravage le haut Languedoc et ne s'arrête qu'à Narbonne, brûlant tout sur son passage.
Après la paix de Calais en 1360, la région doit subir les pillages des routiers
(5), commandés par de redoutables truands.
Les masses populaires exaspérées par la misère, irritées par la fiscalité royale, entreprennent de se révolter.
Tout n'est pas noir pourtant, au cours de cette période qui dure du XIV au XVème siècle, la crise à la longue, a certains effets positifs. La population ayant beaucoup diminué, les difficultés de subsistances deviennent moins pressantes et moins fréquentes. L'alimentation populaire, dans certains domaines, s'améliore. Le mauvais pain d'orge, d'usage courant dans le bas Languedoc aux XII et XIIIème siècles est remplacé autour de 1400 par le pain de seigle, de méteil ou de froment et la viande de boucherie est largement consommée. »
D'après des textes de Emmanuel Le Roy Ladurie "Les paysans du Languedoc" thèse 1966 Paris.
3 Bladade : Droit qui se percevait dans l’Albigeois sous forme de censive
et ainsi appelé parce qu’il consistait dans une certaine quantité de blé payé pour chaque paire de labourage.
4 Nom donné aux paysans qui dévastèrent la France en 1214, en 1251 pendant le séjour de Louis IX en Syrie et en 1320. Les révoltés
de 1251, conduits par le Maître de Hongrie, furent exterminés par ordre de Blanche de Castille, et leur chef tué près de Villeneuve-sur-Cher.
Quant à ceux de 1320, leur départ fut marqué par une jacquerie, et ils furent massacrés dans le Midi, par ordre du sénéchal de Carcassonne.
5 Bandes de partisans, de soldats pillards, au moyen-âge: Du Guesclin débarrassa la France des compagnies de routiers.
La peste de 1630-1632
« Les conséquences les plus directes et les plus immédiates des meurtres, des ruines, des
souffrances et des privations des habitants des villes et des campagnes furent de compliquer une situation généralement
désastreuse. Les maladies contagieuses, la peste surtout, firent leur apparition de 1630 à 1632. Elle avait été
importée du Rouergue, et sévissait à Carmaux, Blaye, St-Benoit et Rosières. L'entrée à Albi était défendue à tous
les habitants de ces communautés. Une victime avait été signalée à la Granaïrié, commune de Carmaux, sur la terre
de Delersanes qui fur invité par le district d'Albi à ensevelir le corps mort et à brûler la maison.
On dût se prémunir contre les batteurs d'estrade, tant du duc de Rohan que de l'armée royale.
Le lundi 14 avril les Docteurs Malhard et Deripes se rendirent à Carmaux avec le chirurgien Audibert. Ils avaient
fait exhumer le cadavre de Golesque fils et trouvé qu'il était mort de la peste. "Il avait un charbon sur l'estomac
à l'endroit du cœur et la tumeur caractéristique sous l'aisselle, le bubon". En outre le corps était couvert de
tâches noires.
L'interdit jeté sur la population de Carmaux et des communautés voisines avait interrompu les
transports de charbon de terre et diminué la consommation. Le meunier Lamothe à Albi avait défense de moudre le
blé ou le maïs des usagers des villages contaminés. Le XVIIème siècle touchait à sa fin et la misère
était à son comble. En l'an 1693 et 1694 les récoltes furent déficitaires et la mortalité épouvantable. Les
inventaires des archives départementales et la revue du Tarn tracent de cette époque un si sombre tableau que
nous n'hésitons pas à en donner la description, bien que nous n'ayons pu y découvrir l'action particulière qu'ils
ont exercé sur Carmaux. »
D'après l’œuvre du Docteur Louis Calmels "Monestiès Combefa" 1932 Rodez
Décadence du peuplement rural
« Une simple médiation, la mort. De quoi meurt-on ? de faim, de malnutrition ou de
carences alimentaires. Types de morts fréquentes surtout en milieux populaires pauvres : brassiers, ouvriers
du textile. Ainsi en 1680-1694, pendant ces années de disette, qui jouent en Languedoc, un rôle provocateur
dans l'amorçage du peuplement. En 1709-1710, beaucoup périrent; en Languedoc, ceux qui s'en tirent, chez les
pauvres, survivent grâce au millet, aux navets, aux fèves, au pire, ils mangent de l'herbe, du pain de chiendent
et des tripailles de moutons. On peut parler d'un retour offensif de la faim à partir de 1680. On meurt aussi,
plus subtilement des maladies contagieuses. Les hommes sous alimentés sont bons vecteurs de contagions car peu
résistant aux germes pathogènes. Mais le dépeuplement en Languedoc est plus tardif que partout ailleurs; 18 % de
l'effectif rural en moyenne et sur deux générations: 1677-1741. Dans certaines situations pourtant, dans les villages
cruellement frappés, l'hémorragie humaine est beaucoup plus forte; Elle peut même dans les cas extrêmes - mortalité
sévère accompagnée d'émigration massive - rayer de la carte un habitat et faire disparaître quelques villages. »
Guerre de religion
« Après la guerre des Anglais, la plus dévastatrice qui ait désolé les pays pendant plus d'un
siècle, de nouvelles calamités venaient s'ajouter aux précédentes. L' édit de 1562 qui visait la pacification des
esprits fut le signal de nouvelles luttes. A cette époque de troubles eurent lieu dans notre région à la suite d'une
querelle survenue entre les carmausins et un nommé Débar se disant gentilhomme de la Compagnie du roi de Navarre en
présence des soldats italiens de la Compagnie de Scipion, attirés en France par les catholiques.
En 1569, les habitants de Carmaux et des environs se plaignaient contre une foule de larcins, de
battements et toutes sortes d'excès de la Compagnie de gendarmerie du capitaine Rochebonne de passage sur le territoire
de Carmaux le 24 octobre 1550. En 1569, un combat sanglant fut livré à Valdériès entre catholiques et religionnaires.
Ces derniers s'étaient rassemblés au nombre de 3000 sous le commandement d'un huguenot de Carmaux, Roudat dit "le borgne".
Lancelot qui commandait à Montmirat envoya le Capitaine Puech pour les réduire. On essaya de forcer les portes, mais
Roudat sortit et mit le feu au faubourg. En 1572, après la St-Barthélémy, St-Benoit fut assiégé et pris par les
huguenots. En 1229, St-Benoit était un fief militaire relevant de la baronnie de Monestiès.
J.B. de Ciron qui de 1674 à 1724 fut conseiller et Président au Parlement de Toulouse était titré
de marquis de Carmaux et de St-Benoit. Ce seigneur maria une de ses filles en 1723 à François-Paul de Solages.
François-Paul de Solages, marquis de Carmaux épousa en 3ème noces le 29 septembre 1724, Marie de Ciron,
dame de Carmaux et fille de M. de Ciron, 1er président au Parlement de Toulouse qui mourut la même année. Par ce mariage la terre de Carmaux, estimée à cette époque 250.000 livres, entra dans la maison de Solages. En 1568 eut lieu à Carmaux une vérification des dégâts causés dans le diocèse d'Albi par les nouvelles religions à l'occasion des ponts de Salles, Monestiès et Carmaux. Et en 1595 fut installée une garnison à la Tour de Carmaux. Nous avons signalé dans un chapitre précédent les difficultés éprouvées par le clergé dans l'exercice de ses fonctions à propos du mauvais état des chemins. Cette constatation n'était pas spéciale à Carmaux, elle s'appliquait à tout le territoire. Si les Romains avaient à cœur de construire de belles routes partout où ils avaient exercé leur domination, il n'en était pas de même en France. La viabilité était très défectueuse au moyen-âge malgré les péages dont le produit lui était affecté, nul ne songeait à l'entretien des routes et des chemins qui, dans tout le pays, étaient effondrés et impraticables.
En Albigeois on ne pouvait marcher qu'à pied et les transports n'étaient possibles qu'à dos de mulet ou par voie fluviale. C'est seulement au XVIIIème siècle que la misère générale imposa partout l'obligation de développer l'industrie et les relations commerciales.
Si l'on se représente les marches et contre marches des bandes armées et des armées qui se croisaient dans tous les sens depuis la féodalité, la guerre de cent ans et les guerres de religion; si l'on se rend compte des déprédations, larcins, vols, ravages, razzias, opérés sur tout le territoire, on n'aura qu'une idée approximative de l'aspect désolé que présentait le pays.
Rappelons que les agents du Roi pressuraient le peuple qu'ils accablaient d'impôts...Toutes les communes étaient taillées. La taille était personnelle; mais dans les provinces du sud, la taille était dite réelle: on se basait alors sur les cadastres. Sur les rôles de la taille, seul le chef de ménage était inscrit; les taillables étaient regroupés par ordre alphabétique des prénoms (à l'origine) puis des noms de famille; la profession ou l'état était parfois mentionné; les non-taillables étaient cités à la fin; à partir de 1763, le rôle devait mentionner le nom, le prénom, le surnom éventuel, la profession, la quantité de terres, le nombre de charrues ou de paires de bœufs. Il fallait couvrir les frais de toute nature exigés tant pour l'entretien des troupes que pour la rançon des prisonniers. Aux subsides de guerre s'ajoutaient encore les appels de Philippe de Valois en faveur de la chevalerie de Jean son fils, duc de Normandie, et pour le mariage de sa fille Marie. Le sénéchal de Carcassonne exigeait 20 livres par feu. Les récusations se multipliaient, les consuls, les bourgeois, les ecclésiastiques se déclaraient impuissants devant les impôts. »
Pour en savoir plus sur Monestiés

|
