Patronyme fréquent dans les Vosges et la Haute-Saône. Dauzat le rattache à l'ancien français
gehine (=torture) et y voit le surnom d'un bourreau.
Mais comment expliquer qu'il n'y ait eu des bourreaux que dans l'Est, et surtout qu'ils y soient si nombreux
(3500 naissances en 100 ans). En fait, il doit s'agir d'un prénom, certainement une variante de Jean, que l'on trouve
aussi sous les formes Jehin (68, 88) ou Jehain (Belgique, où de nombreuses mentions médiévales en font bien un prénom).
Nicolas né le 10-8-1725 et baptisé dans la paroisse de St Jacques de Lunéville. Maître tailleur d’habits, il épouse avant 1763 Christine Agiron. Un enfant connu. Nous ne connaissons pas le lieu de mariage de Nicolas. Le patronyme de sa femme ne prend pas son origine en Lorraine, mais en Isère.
IV - a Benoît né en 1761 et décédé le 4-11-1828 à Les Islettes dans la Meuse. Il est peintre en faïence et épouse le 19-9-1786 à St Amand de Toul Anne Marguerite Demangeot, née en 1766 à Toul. Fille de Nicolas Demangeot et de Catherine Bayard de St Amand Toul. Son frère Charles Bayard, ainsi que le fils de celui-ci, Martin, étaient propriétaires de la manufacture de faïence de Toul Bellevue. Ils étaient témoins au mariage de Catherine Bayard. La famille Demangeot semble être originaire de Gondreville, proche de Toul. Les Demangeot se sont établis à Toul vers 1770-1775. Benoît et Anne Marguerite eurent sept enfants, nés entre Toul, paroisse de St Amand et Les Islettes dans la Meuse.
V - a Charles né le 7 juillet 1787 à St Amand de Toul.
V - b Martin est né le 8-11-1789 à St Amand de Toul. Épouse le 30-12-1822 aux Islettes Christiane Gillet, née le 11 juillet 1795 à Etain. Fille d’Antoine et d’Elisabeth Crutian. Deux enfants connus.
V - b - 1 Jacques Adolphe, né en 1824. Épouse le 3-6-1851 à Les Islettes Christiane Baudette, fille de Jean et de Marie Anne Richot.
V - b - 2 Robert Jacques née aux Islettes, qui épouse le 26-10-1858 aux Islettes,
Victoire Romain, fille de Jean-Baptiste et de feue Anne Adnot. Trois enfants connus.
V - b - 2 - a Euphrasie née en 1859. Épouse le 15-10-1881 aux Islettes, Joseph Hénin, fils de Marguerite Adèle Hénin.
V - b - 2 - b Marie Elisa née en 1871. Épouse le 14-6-1890 aux Islettes, Félix Edouard Hénin, fils de Marguerite Adèle Hénin.
V - b - 2 - c Constance, née en 1872 aux Islettes. Épouse le 12-11-1892 aux Islettes,
Jean-Baptiste Thiblet, né en 1860 à Avocourt, fils de feu Jean-François et de Adèle Breda.
V - c Antoine est né le 30-12-1791 à la collégiale St Gengoult de Toul.
V - d Annet, né en 1794 aux Islettes. Faïencier au Bois d’Epenses, lieu dit situé à l’Ouest des Islettes. Témoin au mariage de Hyacinthe, sa sœur cadette.
V - e Benoîte Félicité, née le 15-12-1797 à Les Senades, hameau rattaché aux Islettes.
Épouse le 10 juin 1822 aux Islettes, Jacques Collard, né le 3-2-1794 à Les Vignettes, hameau de la paroisse
des Islettes mais rattaché en 1792 à Ste Ménéhould dans la Marne. Il est veuf de Anne Demangeot.
Voir famille Collard.
V - f Hyacinthe est née le 4-11-1803 aux Senades aux Islettes. Elle épouse le 14-9-1830 aux Islettes, Anne Gaspard Collard, né le 28-12-1807 à Les Vignettes, commune de Ste Ménehould.
V - g François né le 13-4-1807 aux Islettes, faïencier au Bois d’Epenses comme son frère
Annet. Témoin au mariage de sa sœur Hyacinthe en 1830, il épouse le 4-9-1832 0 Futeau Adélaïde Davocourt, née à
Châlons sur Marne le 3-4-1807. Fille d’Adèle de Bigault d'Avocourt. Un enfant connu. Dans les documents consultés,
nous avons trouvé le patronyme Bigault d'Avocourt écrit Bigault Davocourt ou Davoncourt
Pour en savoir plus sur cette célèbre famille les BIGAULT d’AVOCOURT et les gentilshommes verriers 
Archives
- Série E communale des villes de Lunéville et Toul.
- Série E archives départementales de la Meuse : registres
paroissiaux des Islettes.
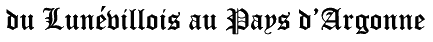
Cas d’une émigration industrielle
L’histoire de la famille Géhin est intimement liée à l’histoire de la faïence de Lorraine. Originaire de Croismare, village situé à quelques kilomètres de Lunéville et de St Clément. C’est là, dès le 18ème siècle, que les membres de la famille seront pour la plupart faïenciers de père en fils. Ils rejoindront ensuite Toul et sa manufacture de Bellevue, puis le pays d’Argonne et les faïenceries du Bois d’Epenses.
Rappel historique
La faïence de lorraine prit son essor au 18ème siècle. Les faïenceries de Lunéville Saint-Clément, les anciennes manufactures royales, sont connues dès 1723 avec leurs célèbres services de table, les non moins célèbres "Chiens de Fô" qui sont à l'origine de l'expression de la langue française "se regarder en chiens de Faïence" .
En 1728, Jacques Chambrette fonda à Lunéville la première manufacture de faïencerie de Lorraine. L’établissement va alors connaître un grand essor économique et artistique et très vite attirer les faveurs de la noblesse. En 1749, les ducs de Lorraine lui accordent la qualification de "Manufacture Royale de Fayence". Encouragé par ses premiers succès, Jacques Chambrette crée en 1758 la Manufacture de Saint-Clément (à 10 km de Lunéville), spécialisée dans la fabrication de prestige. La faïencerie deviendra alors le fournisseur de la Reine Marie-Antoinette pour son Trianon.
Les manufactures de Lunéville et Saint-Clément ouvrent ainsi à travers le temps leurs fours à une pléiade d’artistes lorrains : Cyfflé, Bussière, Lachenal, l’immense Gallé, Géo Condé, Lemanceau, des céramistes Joseph & Pierre Mougin avec Goor, Ventrillon le Jeune, Wittmann, et bien d'autres…
Depuis 250 ans, la faïencerie diversifie ses productions, grâce à la passion des connaisseurs de la faïence fine, du "peint main", de l’Art Nouveau du XIXe à l’Art Déco du XXe.
La marque "K & G" est sur les tables du monde entier avec ses services "Réverbère", "Chinois" et ses coqs triomphants de Lachenal sur barrière ou sur corbeille fleurie.
En 1922, la famille Fenal dirigeant la Manufacture de Badonviller devient propriétaire des manufactures de Lunéville, Badonviller et Saint-Clément.
Pièce Emile Gallé
A l’aube du XXIe siècle, la Manufacture de Lunéville - Saint-Clément poursuit les fabrications traditionnelles qui ont bâti sa renommée. En recherche permanente d’un renouvellement de l’art de la faïence, elle veut allier l’imagination de designers de talent au savoir-faire de ses faïenciers.
Un grès de Mougin
L'histoire de la Faïence
Le terme "faïence" tire son origine d’une petite ville d’Italie, Faenza, qui fut, à partir du XVe siècle, un grand centre de fabrication céramique. Ces produits se reconnaissaient par l’application d’une couche d’émail opaque dissimulant la couleur naturelle de la terre cuite.
L’art de façonner la terre et de la décorer apparaît dès la préhistoire et il se maintient sans discontinuité jusqu’à l’époque industrielle contemporaine. L’art de la faïence proviendrait des pays islamiques du Moyen et du Proche Orient : Perse, Mésopotamie, Syrie, Egypte. Mais la Renaissance italienne et les mouvements artistiques français et anglais du XVIIIe siècle imposèrent de nouvelles techniques dans toute l’Europe. Deux siècles plus tard, la fantaisie des décors, des formes et de l’apparence des matières, s’exprimeront pleinement durant l’Art Nouveau.
Petit à petit, au cours des siècles, la céramique a transformé l’univers quotidien en associant la technique, l’artistique et l’esthétique, de la vaisselle aux baignoires, des lampes aux carreaux de céramique.
Si Jacques Chambrette (1702-1758) ne s'était pas installé à Lunéville, en ce début du XVIIIe siècle, Lunéville aurait-elle accolé son nom à une faïence de haute qualité artistique ?
On ne peut l'affirmer. Car, le Pays de Lunéville comptait déjà des artisans faïenciers qui excellaient dans la création d'objets utilitaires ou décoratifs.
Ce n'est donc pas par hasard que Chambrette donna son nom à une faïencerie qui, née sous Léopold, prospéra comme manufacture royale sous Stanislas.
L'époque était favorable à la faïence qui vint remplacer la vaisselle plate (métaux précieux), souvent refondue pour permettre au Roy de battre tambour.
De la fenêtre de leurs ateliers, les artistes regardaient s'épanouir les fleurs de Lorraine. Tout comme les frères Hannong le firent à Strasbourg, la vaisselle se couvrit de décors variés et originaux: fleurs, insectes, animaux familiers et chimériques, personnages exotiques et chiens de faïence placés dans les vestibules (d'où découlerait l'expression se regarder en chiens de faïence).
Vint alors la mode du chinois, que les Jésuites ramenèrent de leurs missions souvent périlleuses.
Jacques Chambrette, écrasé par les impôts très élevés en terre ducale, par le fait de Chaumont de la Galaizière, gouvernant pour le roi de France, lorgna vers le territoire épiscopal rattaché à la France, où les sujets de Louis XV étaient beaucoup moins étranglés.
Chambrette installa des faïenceries à Saint-Clément, terre de l'évêque de Metz.
Au XlXe siècle, la famille Keller d'origine allemande, bientôt alliée aux Guérin, redonna vie aux faïenceries en les industrialisant. Grande époque où Lunéville et les environs fournirent une main d'oeuvre compétente.
Le quartier des faïenceries, sous le patronage de Sainte Anne, se développa.
Les Fenal, venus de Pexonne et de Badonviller, prirent la succession de l'entreprise, conservant à Lunéville et à Saint-Clément des emplois sûrs.
La deuxième guerre mondiale marque le déclin.

Quelques marques Lunéville - Saint-Clément
Après l'âge d'or du XVIIIe siècle, seuls demeurent en activité vers 1900 Longwy, Lunéville, Saint-Clément, Pexonne, Niderviller, Sarreguemines et Toul-Bellevue, ainsi que Rambervillers et Badonvillers. Bientôt s'ouvre l'ère des restructurations financières qui aboutissent à des réorganisations. Toul-Bellevue disparaît avant la Seconde Guerre mondiale. Niderviller a failli subir le même sort ces dernières années. Vicissitudes également pour Longwy. A son apogée vers 1900, elle a compté jusqu'à 450 employés. A partir de 1930, l'instabilité économique est à l'origine des difficultés de l'entreprise qui ne peut rétablir après 1945 sa production de faïence d'usage. En 1977, elle cesse son activité, la tradition des émaux continuant cependant. Avant d'être réunies à partir de 1979 au sein d'un groupe unique, les faïenceries de Lunéville, Saint-Clément et Sarreguemines ont connu de grandes heures. Concernant Lunéville (un incendie la terrasse en 1968) et Saint-Clément, c'est en 1922 que le groupe Fenal en prend le contrôle, ainsi que Badonvillers. Sarreguemines est l'une des premières faïenceries d'Europe vers 1900, employant 3 000 ouvriers. Rachetée par le groupe Lunéville-Saint-Clément, elle s'est orientée vers la fabrication de carrelage. Globalement, à la fin 1994, ce sont moins de 2 500 salariés qui sont occupés dans la faïencerie en Lorraine.
Un atelier aux faïenceries de Lunéville
"K & G " au début du siècle.
Les origines des faïenceries d'Argonne
L'étude approfondie des registres paroissiaux, documents importants mais souvent négligés, apporte des précisions fort utiles et permet de rétablir les faits avec plus de véracité. Le plus ancien témoignage concernant les faïenceries d'Argonne se trouve dans l'histoire du célèbre monastère Saint-Maurice de Beaulieu-en-Argonne, rédigée par dom Baillet, au début du XVIIIème siècle. Le moine de Beaulieu écrit en effet : "12 mai 1709, un parti détaché de la garnison Trabach se répandit dans le Clermontois. L’un des chefs de cette troupe surprit, à Waly, les sieurs Nicolas, seigneur de Waly et Leclerc, son beau-frère, qui venaient d'y fonder une faïencerie déjà prospère. "
Si par la suite on ne parle plus de Mathieu Nicolas, gentilhomme de la Grande Fauconnerie du roi et seigneur de Waly, il n'en est pas de même pour Nicolas Leclerc, devenu son beau-frère en épousant Marguerite Nicolas vers 1693.
Nicolas Leclerc, né à Clermont-en-Argonne le 18 août 1665, était le fils de Louis Leclerc, notaire, tabellion et maître des eaux et Forêts dès 1687, il est cité lui-même comme maître particulier des Eaux et Forêts.
Le jeune ménage habite Clermont pendant une première période qui va de 1696 à 1707. Au cours de ces
onze années. Ils ont sept enfants (dont quatre meurent en bas âge). Il ne leur reste alors que :
- Henri Louis, né en 1701, et qui, malgré deux mariages, mourra sans postérité
- Elisabeth, née en 1703, qui épousera Joseph Cuny, gendarme du roi;
- Nicolas, né en 1707 dont on perd la trace.
En 1708, les Leclerc ont quitté Clermont pour Waly, peut-être habitent-ils chez Mathieu Nicolas. Leur résidence dans cette localité est attestée par l'acte de baptême de Marguerite Sauvager qui figure sur les registres paroissiaux de Waly en date du 24 avril 1708. Les époux Leclerc y sont parrain et marraine et porte la mention " demeurant à Waly ".
C'est à cette époque qu'il faut fixer le début de la faïencerie de Waly (première trace en décembre 1707), celle dont nous parle dom P. Baillet. Nous sommes aux temps difficiles de Louis XIV. Les désastres militaires successifs ont contraint le roi, à court argent, à vendre ses meubles précieux et sa vaisselle d'or. Ayant ainsi montré l'exemple, il invite tous les propriétaires de vaisselle d'argent à porter celle-ci à la Monnaie pour être fondue, ils devront alors se contente de vaisselle de terre.
Cette mesure occasionne aussitôt une demande pressante de faïence sur les marchés et ce besoin impérieux provoquera dans les années qui suivent toute une floraison de nouvelles faïenceries Dôle, Bordeaux, Champigneulles, Aire-sur-la-lys, Aubagne, Besançon, etc...
De par sa charge de maître des eaux et Forêts, Nicolas Leclerc a pour mission de tirer le meilleur parti de l’exploitation des bois. Certes, les verreries absorbent une partie de la production forestière, mais les gentilshommes verriers s'opposent à toute multiplication des établissements par crainte de la concurrence.
Nicolas Leclerc voit dans l'industrie de la faïence une double solution : la création d'une faïence augmentera la consommation de bois sans nuire aux intérêts des verreries. Les besoins actuels en faïence lui servent de prétexte, mais il est fort probable qu'il a préparer son affaire de longue date.
Depuis quelques années en effet, on a vu arriver des étrangers à Waly; Des gens dont la profession
nous est inconnue, mais dont on peut remarquer par la suite les alliances avec des faïenciers.
- en 1693, c'est Jean Chargeboeuf, âgé de 52 ans, originaire d'Auvergne et dont les filles épouseront des faïenciers.
- en 1701, c'est Noël Soulesgout (devenu Soligot) qui se marie à Waly. Il est originaire de Saint-Beausire, en Auvergne
et sa mère est née Chargeboeuf.
- en 1703, c'est François Chabrillat, âgé de 33 ans et originaire de Trouchat en Auvergne. Après son décès, survenu à
Waly en 1710, sa veuve épousera un peintre en faïence par la suite sa fille épousera un Soligot.
En dix ans, voilà trois familles venues d’Auvergne, de cette Auvergne qui fournissait alors bon nombre
de maçons. Que viennent faire des maçons dans un pays où règne le torchis ? Ne les aurait-on pas fait venir pour
construire une faïencerie, et son four en particulier ?
Cette supposition se trouve confirmée par un document de 1768. Dans un procès qui l'oppose à la veuve
Carpentier, alors propriétaire de la manufacture de Waly, Joseph Bernard, son locataire proteste contre l'état de
vétusté du toit de la manufacture, surtout au-dessus du four. Il assure que la toiture incriminée a plus de cinquante
ans d'existence. Cette déclaration situe la construction de la manufacture au début du siècle, ce qui correspond à
l'arrivée des familles auvergnates.
Lorsque Nicolas Leclerc arrive à Waly, les gros travaux sont terminés. Les spécialistes peuvent venir; Ils ne tarderont
pas.
En 1708, c'est Jacques Sauvage (ou Sauvager), 38 ans, marié à Marie Dussart. Il meurt à Waly en 1710. Bien que rien
ne le prouve, il est probable qu'il était faïencier.
Eu 1713, sa veuve se remariera à Champigneulles, avec François Cartier, l'un des futurs fondateurs
de la faïencerie de Montigny-lès-Vaucouleurs. C'est à Montigny que sa fille épousera en 1743, Etienne André, un
tourneur en faïence venu de Nevers.
En 1711, c'est Jacques Frappat (ou Frappart) peintre en faïence, né à Varage dans le Var, et (Il a dû travailler en 1711)
à la manufacture de faïence de Marseille-la-Joliette. Il épouse à Waly, en 1711, Anne Manget, la veuve de François
Chabrillat.
Puis on le retrouve peu après à Champigneulles, où l'une de ses filles a pour parrain Jacques Chambrette, alors
faïencier à Champigneulles mais qui devait par la suite, créer la faïencerie de Lunéville.
En 1711 également, c'est François Jacques Chicanneau, originaire de la paroisse de Saint-Cloud,
près de Paris. Il se marie à Waly en 1711 et part aussitôt pour Champigneulles, où Jacques Chambrette, déjà nommé,
est parrain de son fils Jacques, né le 8 septembre 1711. Lorsqu'on sait qu'un certain Pierre Chicaneau a fondé en
1677 une faïencerie à Saint-Cloud, on est convaincu de la qualité de faïencier de ce nouvel arrivé, bien que sa
profession ne figure sur aucun document.
Toujours eu 1711, c'est Jacques-Henri Carpentier, mouleur en faïence, né vers 1685 à Rouen, paroisse Saint-Sever.
Hélas, après 1711, de tous ces spécialistes, il ne reste que J.-H. Carpentier ; le sort de Waly
est désormais entre ses mains. Quelle fut la cause de cette désertion massive ? Un échec technique, une gêne
financière ? Rien ne permet de l'affirmer, ou de l’infirmer. Il est probable, par contre, que l'insécurité qui
régnait alors à Waly, village non fortifié, a contribué pour beaucoup à cet abandon. L'épisode cité par dom P.
Baillet illustre assez bien la situation.
Nicolas Leclerc lui-même a regagné Clermont où Marguerite Nicolas lui donne deux nouveaux enfants :
Catherine et François-Richard. Catherine, née en 1711, épousera en 1750 Christophe Ducou, et sa propre petite-fille,
Anne Ducou, deviendra plus tard l'épouse de Philippe Marcou-Robert, propriétaire de la faïencerie de Salvanges de 1811
à 1830. Quant à François-Richard, né en 1715, il entrera dans les ordres (chez les chanoines de Montfaucon).
Resté à Waly, j.-H. Carpentier a aussi de nouveaux enfants; En 1712, c'est Lucie dont une fille
épousera Nicolas Denizet, faiencier à Waly puis à Lavoye. En 1713, c'est Henri Gervaise qui sera faïencier à Waly
jusqu'à son décès accidentel survenu en 1742. En 1715 enfin, c'est Claude 1er que certains considèrent à tort comme
le fondateur de Waly.
J.-H. Carpentier a-t-il abandonné la céramique ? Certainement pas. Il continue ses travaux mais reste à un niveau
artisanal tout en maintenant le contact avec Nicolas Leclerc.
En 1710, vit à Waly un certain Laurent Boizard qui, pour le baptême de sa fille, choisit J.-H. Carpentier comme parrain.
Ce fait paraîtrait banal si on ne savait qu'en 1747, il existera à Béziers une veuve Boizard, fabricante de faïence.
Cette présence démontre que J.-H. Carpentier emploie encore du personnel et par là même que la fabrique n'a pas été
anéantie.
De son côté, à l'abri du château de Clermont, Nicolas Leclerc a ouvert un atelier. Ses rapports avec J.-H. Carpentier
sont toujours aussi cordiaux puisque, en 1718, il le place à la tête de la manufacture de Clermont. J.-H. Carpentier
vient habiter la ville, mais n'y reste pas beaucoup de temps. Dès 1720, peut-être à la suite d'une brouille, il
regagne Waly et y reprend son travail personnel. Les deux faïenceries de Waly et de Clermont vont désormais mener
des existences parallèles.
A Waly, J.-H. Carpentier semble avoir de nouveaux ennuis. Sa femme meurt le 8 juin 1724. Il se remarie peu après avec
Frauçoise-Thérèse Greffier, dont on ne sait rien, Si ce n'est qu'elle est étrangère au pays.
En 1726, voici Pierre Dhèry, faiencier; Il reste peu de temps à Waly et dès l'année suivante il
travaille à la manufacture de Clermont.
Après son départ, J.-H. Carpentier a dû quitter Waly jusqu'à 1732. En effet, s'il est encore présent en décembre 1727
(décès de sa fille Agnès), on ne le retrouve plus que le 14 juin 1732 au décès de Jacques-Joseph, un fils né du second
mariage, or cet enfant dont on ignore l'âge, n'est pas né à Waly.
Il semble que, peu à peu, J.-H. Carpentier se détache de Waly. A quoi peut-on attribuer cette attitude?
Une déception professionnelle ? Rien ne le prouve. Une mésentente entre sa seconde épouse et les enfants liés de
son premier mariage et qui sont déjà grands ? Cela n'est pas impossible.
On peut également envisager une certaine influence de la famille de Françoise-Thérèse Greffier, l'attirant vers le
lieu de résidence de ses beaux-parents, endroit resté inconnu jusqu'à Présent.
Avant de tout quitter, J.-H. Carpentier a su former ses deux fils. Tous deux seront faïenciers comme lui;
Malheureusement l'aîné Henri-Gervaise meurt accidentellement à 29 ans. Son père assiste à ses obsèques à Waly
le 29 août 1742, puis disparaît de la région avec sa femme et leurs enfants. On ne le reverra jamais. Peut-être
a-t-il regagné son Rouen natal ou essaimé vers quelque autre faïencerie. Là encore, toutes les suppositions
sont permises.
Pendant ce temps, à Clermont, la situation n'est guère plus brillante. Nicolas Leclerc meurt en
1722 son fils Henri-Louis, âgé de 21 ans, reprend l'entreprise paternelle. La présence à ses côtés de Pierre Dhéry
(1727 et 1728) et de Laurent Boizard (décédé à Clermont en 1731) confirme la continuité de l'oeuvre. Par contre,
l'absence totale de participation de j.-H. Carpentier consacre la rupture de l'axe Waly-Clermont.
En 1735, voulant renouveler l'essai de décentralisation que son père avait tenté à Waly, Henri-Louis, tout en
conservant son établissement de Clermont, établit une faïencerie au Bois d'Epense, près des Islettes. En 1739,
il l'exploite encore, aidé d'un sieur Talma (sans doute joseph Talma, seigneur en partie du Bois-d'Epense),
mais en 1742, cette faïencerie cesse toute activité et Henri-Louis revient définitivement à Clermont.
En 1753, un jeune chirurgien, François Harmand, qu'on dit originaire de Samogneux (ce qui n'est
pas prouvé), se marie à Clermont et s'y installe. Il s'intéresse à la céramique et, sans doute conseillé par Henri-Louis
Leclerc (et peut-être même formé dans sa manufacture de Clermont), il sera en 1760 le fondateur de la faïencerie
de Salvanges.
L’année 1702 semble vouloir apporter à Clermont un regain d'activité avec l'arrivée presque
simultanée de Georges Lacour, tourneur en faïence, de J.-B. Nicolas, faïencier et des deux frères Bernard, également
faienciers : Jacques Bernard dit " La Douceur" qui vient des faïenceries d'Épinal et François Bernard, né le 7 avril
1739 à Champigneulles, où leur père était déjà ouvrier-faiencier. Tous resteront dans la région et y feront souche.
Georges Lacour travaillera par la suite à la faïencerie de Froidos. On trouvera son fils Jacques. également tourneur
en faïence, à Salvange et à Froidos. Sa fille Marie-Anne épousera à Froidos, Antoine Denizet, un tourneur en faïence,
originaire de Fleury-sur-Aire.
J.-B. Nicolas, dont on ignore l'origine mais qui pourrait être apparenté à Henri-Louis Leclerc,
dont la mère était née Nicolas, rejoindra à Salvange, François Harmand qu'il a connu à Clermont.
En 1765, François Bernard aidé de son frère Jacques rouvrira la faïencerie des Islettes, fermée
depuis 1742 (cette réouverture fut autorisée par un arrêt du Conseil en date du 3 juillet 1764). En 1768, Jacques
Bernard sera sur le point de quitter son frère pour rejoindre la direction de la manufacture de Waly mais l'affaire
ne se fera pas.
Veuf en 1752, Henri Louis Leclerc se remarie avec Marguerite George, originaire de la paroisse de Saint-Amand-de-Toul
(pays de faïenciers). Malgré ses deux mariages, il n'eut pas d'enfants et mourut à Clermont le 19 décembre 1783
(21 jours après sa femme).
Lorsqu'en 1791 Rémy Humbert, fils d'un marchand tanneur et gendre de François Harmand, s'établit faïencier à Clermont,
il ne s'agit pas comme on le croit généralement d’une création, mais de l'industrialisation d'une œuvre vieille
déjà de 80 ans.
Resté seul à Waly, comme son père en 1711, Claude Carpentier Ier du nom, ne reste pas inactif et
tente de survivre, à défaut de s'agrandir. Certains nient son œuvre parce que sa qualité de faïencier ne figure sur
aucun des registres paroissiaux, si ce n'est à sa mort en 1766. Cette omission ne prouve absolument rien car, pendant
toute cette période, on ne relève sur ces mêmes registres, aucune mention de profession, ce qui est regrettable.
Marié en 1745 à Lucie Pasquier, Claude Ier a sept enfants, qui pour la plupart resteront liés à la céramique :
- 1746 naissance de Lucie qui épousera un marchand de faïence ;
- 1748 : naissance de Jean-Baptiste, 1'ainé qui succédera à son père après avoir épousé Marguerite Cadiat;
- 1750 : naissance d'Henri qui épousera à Beaulieu, Catherine Legris. Bien qu’habitant Beaulieu, il sera pendant toute
sa vie peintre en faïence à la manufacture de Waly. Son fils Jean-Baptiste-Toussaint (1780-1821) sera également
peintre en faïence.
- 1754 : naissance de Louise-Marguerite qui épousera Antoine Himonet, tourneur en faïence venu des Islettes et dont
la descendance sera fidèle à la céramique.
- 1756 : naissance de Thérèse qui épousera un maçon.
- 1763 : naissance de Jean-Baptiste le jeune dont un fils sera tourneur en faïence.
- 1758 : naissance de Claude II. En 1786, il quittera la céramique pour la culture, mais trois de ses fils y
reviendront :
- Nicolas-François, 1786-1846, tourneur en faïence.
- François-Casimir, 1788-1856, peintre en faïence.
- Claude III, 1782-1822, fondateur de la deuxième faïencerie de Waly.
En 1756, pour des raisons encore inconnues, Claude Ier doit quitter la direction de son entreprise.
Certains veulent y voir la preuve de difficultés financières; Cela reste à démontrer. N'est-il pas plus logique
d'envisager des ennuis de santé? Depuis des années, il se bat pour continuer l’œuvre paternelle; il est épuisé.
Il n'a que 41 ans, mais dans dix ans il sera mort. Miné par la maladie et le surmenage, il doit restreindre ses
activités et met en location sa faïencerie tout en s'y réservant un emploi de peintre en faïence.
Son premier locataire est Antoine Lamy, originaire de Mathaux (Aube) (voir aussi les Islettes). Il ne reste pas
longtemps car, dès 1760, il a regagné Mathaux où il meurt le 6 février 1763 (son acte de décès le dit : entrepreneur
de la Manufacture royale de faïences de Mathaux).
Claude Ier fait alors appel à François-Louis Noë1, originaire de Void où son grand-père était procureur. Quand son
père mourut, François-Louis n'avait que trois ans. Sa mère se remaria peu de temps après avec Pierre Vautrin,
chirurgien, originaire de Girauvoisin (Meuse) à qui elle donna quatre fils qui, comme François-Louis se lancèrent
dans la céramique :
- Joseph-Pierre Vautrin (1740-1808) travailla à Lavoye et Salvange.
- François-Nicolas Vautrin (1747- ?) travailla à Lavoye, Salvange, Chigny (Aisne) et aux Islettes.
- Pierre-François Vautrin (1745-1803) fut maître faïencier à Epinal.
- Claude Vautrin (1750-1792) fut maître de la manufacture de Salvange dès 1774.
D'où leur vint ce goût de la céramique ? Où firent-ils leur apprentissage ? Void n'a pas de
faïencerie; la plus proche est à Montigny-lès-Vaucouleurs; plus loin, il y a Toul et Lunéville. Aucun document,
jusqu'à présent, n'a permis de trouver des traces de leur passage dans ces établissements; Cependant, leur
qualification professionnelle suppose une assez longue formation.
François-Louis Noël est encore à Waly à la mort de Claude Ier, survenue le 12 novembre 1766; Mais en 1768, son contrat
terminé, il part pour Lavoye où, aidé de trois de ses demi-frères, Joseph-Pierre, François-Nicolas et Claude Vautrin,
il établit sa faïencerie personnelle.
Pour lui succéder, Lucie Pasquier, la veuve de Claude 1er, contacte Jacques Bernard qui dirige alors avec son frère
la faïencerie des Islettes, Par contrat, Jacques Bernard s'engage à prendre dans la fabrique les deux fils de
Claude Ier pour leur apprendre le métier de peintre en faïence. Des contestations s'élèvent rapidement, attestées
par un procès où il est question notamment de la vétusté des locaux, et le contrat est rompu.
Lucie Pasquier s'adresse alors à Dominique Pierrot de la faïencerie de Montigny-lès-Vaucouleurs. Celui-ci accepte et
arrive à Waly avec deux de ses frères. Il faut croire que Dominique fut en tous points parfait, car le 29 janvier 1770,
il épousait sa propriétaire, de vingt ans son aînée. En 1771, Lucie Pasquier, cède la fabrique à son fils Jean Baptiste
Carpentier l'aîné. Avec lui, l'usine entre dans une période de prospérité.
L'Argonne a maintenant ses cinq grandes manufactures : Waly, fondée vers 1708 par Nicolas Leclerc
et J.-H. Carpentier; Clermont, fondée vers 1712 par Nicolas Leclerc; Les Islettes Bois-d'Epense, fondée en 1735
par Henri-Louis Leclerc, fermée en 1742 et reprise en 1765 par François et Jacques Bernard, venus de Clermont;
Salvanges, fondée en 1760 par François Harmand venu de Clermont; Lavoye, fondée en 1768 par François-Louis Noël,
venu de Waly.
A celles-ci viendront s'ajouter au cours des ans, des faïenceries plus modestes. En 1774, après avoir quitté Salvanges,
François Harmand aurait créé une petite fabrique à Montgarny (face à Salvange)
- vers 1796, J.-B. Denizet, installe à Lavoye une petite faïencerie qui ne concurrencera jamais celle de François-Louis
Noël.
- vers 1817, Claude III Carpentier, tourneur en faïence à Waly, y établit sur le conseil de son oncle J.-B. Carpentier
l'aîné, alors maître de la manufacture à Waly, une petite fabrique chargée de produire de la vaisselle commune, alors
que J.-B. Carpentier se réserve la fabrication des produits supérieurs.
En 1820, Claude-Nicolas Munier, habitant à Montgarny, ouvre un atelier à Froidos. En 1831, les Vercollier, après avoir
travaillé à Froidos, montent une petite faïencerie à Rarécourt. Toutes ces faïenceries découlent, plus ou moins
directement, de l'initiative créatrice de Nicolas Leclerc. C'est lui qui forma et encouragea les premiers
faïenciers dans son atelier de Clermont, qui fut un véritable séminaire de la céramique.
Source : article est tiré d'une publication de Léon Ancement natif de Waly.




Faiences des Islettes 19ème siècle
La faiencerie des Islettes
C'est dans le village des Islettes, situé en forêt d'Argonne, dans le département de la Meuse, au lieu dit "le Bois d'Epense", qu'a vécu environ 80 années, de 1735 à 1848, la faïencerie des Islettes.
Comme beaucoup de ces manufactures qui ont vu le jour au 18° siècle, c'est une histoire de famille. En effet la famille Bernard y a régné pendant 70 ans. En 1765, François Bernard, maître faïencier, relance cette fabrique de faïence. Très vite sa notoriété dépasse les limites de la Champagne et de la Lorraine pour conquérir une part de marché à l'étranger. Il décède en 1800 mais laisse à son épouse une affaire florissante. Celle ci se fait aider par son fils qui apporte son savoir-faire dans la technique de la cuisson au "petit feu". Son épouse sert
de modèle à de nombreux décors. Cette dernière, aidée de son fils dirigera même l'entreprise et de main de maître. C'est sous sa direction que seront produites les plus belles pièces, attirant une clientèle tant bougeoise que paysanne, par le renouvellement incessant des collections. La dynastie des Bernard s'arrête à sa mort en 1836. La manufacture est vendue par les enfants aux frères Godechal.
Les frères Godechal confrontés rapidement à des difficultés financières dûes à l'augmentation du prix du bois (combustible) et à la concurrence française et anglaise, ne purent que fermer la manufacture en 1852, soit douze années après leur achat. La terre des Islettes est trouvée sur place Elle présente un grain fin et est de ton jaune, voire rosé. Elle est lourde mais sa plasticité est élevée. Elle est recouverte d'un émail qui prend des teintes verdâtres, bleutées, grises et rosées.
La production principale est constituée de pièces plates (assiettes, plats ...). Les pièces de forme (soupières, pots à eau, pichets,gobelets, moutardiers, raviers...) sont moins nombreuses. Sont également produites des pièces utilitaires, décoratives et religieuses.Quelques statuettes ont été fabriquées. Elles s'attachent à représenter des figurines d'hommes célèbres, corporatives ou des quatre saisons et voire quelques Anim1aux de la ferme. Les faïences des Islettes ne portent, en général, ni date, ni signature. Seul leur décor les raccroche à une époque.
Pour les décors, les Anim1aux tiennent une place prépondérante. Rare sont les espèces non représentées sur ces faïences. Même les Anim1aux de la ferme, le coq en particulier, sont peints.
En décor fin, c'est le floral qui prédomine soit en fleur isolée soit en bouquets de fleurs noués. Les liserets et ailes d'assiette sont des guirlandes de feuillage.
L'influence extrême-orientale est également perçue dans certains décors réalisés par le célèbre peintre faïencier Dupré. Ils représentent des chinois dans les scènes de la vie, souvent dans des décors champêtres. Le plus célèbre est le "chinois au gros doigt", le plus souvent de profil pour ne représenter qu'une seule main. Les décors ont également suivi l'histoire. Des scènes historiques des différentes époques (révolution, empire, royauté) ou des emblèmes patriotiques (coq chapeauté d'un bonnet phrygien,fleurs de lys, laurier, palmes, couronne, aigle, cocarde ...). Les décors de paysage ont également eu leur époque. Il s'agit souvent de scènes de la vie quotidienne. Certaines pièces constituent un véritable catalogue de mode des différentes époques. On y retrouve d'ailleurs Madame Bernard en portrait ou en pied, car elle servait de modèle aux artistes peintre-faïenciers. Ont été également représentées quelques scènes galantes dont certaines allèrent jusqu'à la grivoiserie.
Mémoire signifié par les sieurs de Bigault en 1757 (Bibliothèque Nationale, dépôt des imprimés, série des factums, FO F3 FM 1475 :
" La première charte des verriers du Clermontois est l'acte de 1448 de Jean de Calabre... La famille de Bigault passe pour un des plus vieux lignages de l'Argonne. D'après un arbre généalogique semblant remonter au XIVe siècle, un Claude de Bigault, comte d'Harcourt, seigneur de Bersy, près de Concressault en Berry, vint en l'année 1328, s'établir à Quincy en Argonne."

